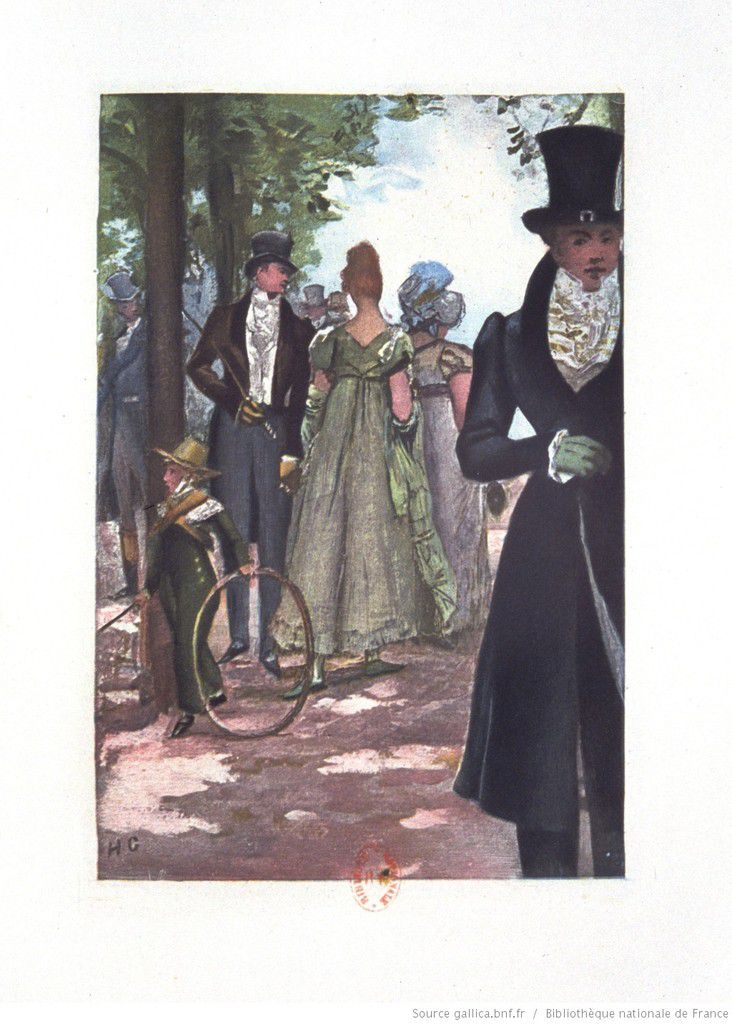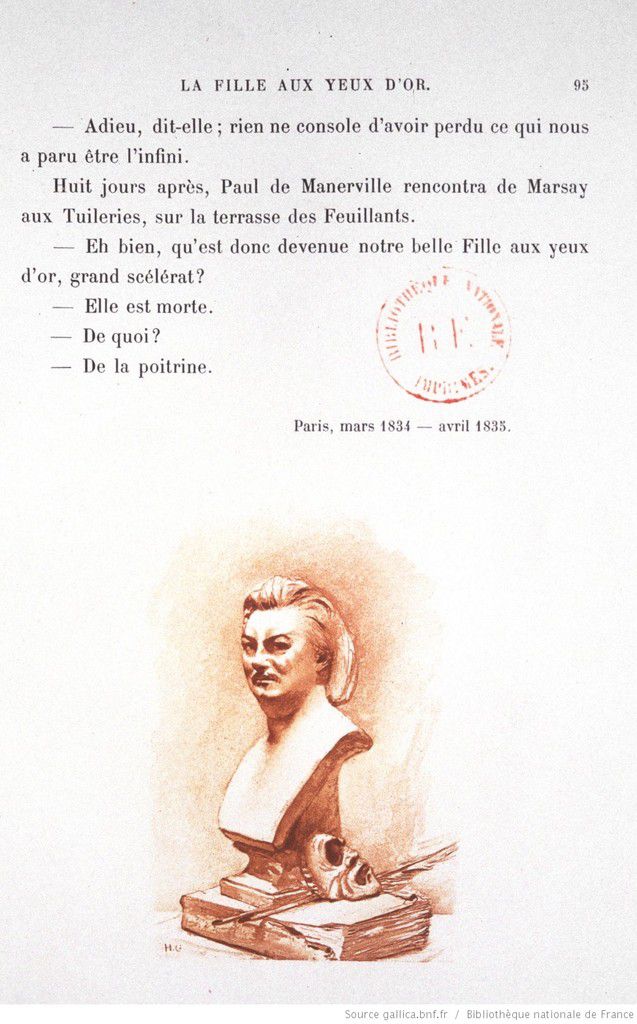Balzac - La Fille aux yeux d'or. Paquita Valdès compte sur ses doigts les douze jours qu'elle et Henri pourront passer ensemble.
La Fille aux yeux d’or (1834-1835) qui devait s’intituler La Femme aux yeux rouges, puis La Fille aux yeux rouges, compose avec Ferragus (1833) et La Duchesse de Langeais (1834) la trilogie que Balzac a réuni sous le titre Histoire des treize. La Fille aux yeux d’or est dédié, tardivement, en 1841, au peintre Eugène Delacroix. Cette dédicace nous indique d’emblée l’une des intentions de Balzac, pas toujours signalée par les critiques. On a dit que Balzac voulait, par ce texte, rivaliser avec le peintre, qu’il voulait, par l’écriture, brosser un tableau où les fastes de l’Orient et ses passions mortelles aurait la même force, la même puissance, les mêmes effets que certaines scènes peintes par Delacroix. Cette idée n’est pas étayée, bien que tout soit possible lorsqu’il s’agit de Balzac. Ce que je pense, c’est qu’étant sensiblement du même âge, ils portent forcément le même regard pour tout ce qui a trait à l’Orient, objet alors de tous les engouements à Paris.
Après un voyage qui a duré plus de six mois, Delacroix revient du Maroc en août 1833. Il vient d’exposer au Salon de 1834, année de parution du roman, Femmes d’Alger dans leur appartement - « tableau d’intérieur, blond, clair, limpide » selon Fromentin ou « poème d’intérieur » selon Baudelaire. Mais la toile qui évoque le plus La Fille aux yeux d’or est La femme caressant un perroquet (1827). « Si j’étais riche, écrit Balzac à Mme Hanska, je vous enverrai un tableau de Delacroix. » L’écrivain en effet est tombé amoureux de cette femme étendue à moitié nue caressant le plumage de cet animal exotique. Il fait décorer d'ailleurs son boudoir aux chaudes couleurs de l’Orient. Dans l’esprit de la critique Delacroix demeure l’auteur de La Mort de Sardanapale, œuvre magistrale de 1827 mêlant mort et érotisme, qui fut un échec auprès de ses maîtres (dont le baron Gros) et un énorme scandale face aux tenants de la peinture classique, surtout davidienne. L’Institut, l’Académie, la plupart des journaux l’ont accablé d’injures. Au moment de la publication de La Fille aux yeux d’or, en 1834, celui qui a « massacré la peinture » ou qui « peint avec un balai ivre » ou « jette des seaux de peinture sur la toile » est toujours vilipendé. Il est détesté, incompris, banni des cercles officiels mais reconnu comme chef de file par les remuants adeptes de la nouvelle peinture romantique. Cette situation, Balzac la connaît. Il la vit. La presse à chacune de ses publications crache sur cet écrivain « qui ne sait pas écrire » comme elle crache sur Delacroix « qui ne sait pas dessiner. » Je verrai donc cette dédicace comme une main tendue à un frère des mauvais jours, un pied de nez à la critique institutionnelle et un rappel nostalgique à leurs jeunes années.
Dès 1832, Balzac a voulu écrire un volume de Fantaisies à caractère oriental. Un sujet jamais réalisé nous est donné : « L’intérieur d’un harem. Une femme aimant une autre femme et tout ce qu’elle fait pour la préserver du maître. » L’Orient hante Balzac, et la France de son temps, l’Orient imaginé voluptueux et cruel où s’exacerbe le désir. Cet Orient, Balzac le reconnaît dans la peinture de Delacroix : il y a repéré des éléments de son rêve « asiatique ». Le thème littéraire « de l’amour d’une femme pour une autre femme » n’est pas neuf. Balzac a lu les romans de Crébillon et de Diderot. Il cite dans La Fille aux yeux d’or le roman de Laclos et un titre incertain du marquis de Sade. Balzac profite de ce passage pour évoquer les corruptions du monde et son hypocrisie. « On nous parle de l’immoralité des Liaisons dangereuses, et de je ne sais quel autre livre qui a un nom de femme de chambre ; mais il existe un livre horrible, sale, épouvantable, corrupteur, toujours ouvert, qu’on ne fermera jamais, le grand livre du monde, sans compter un autre livre mille fois plus dangereux, qui se compose de tout ce qui se dit à l’oreille, entre hommes, ou sous l’éventail entre femmes, le soir, au bal. » Balzac a sans doute parcouru, avant sa publication, le roman de son ami Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin. Il a lu, de manière sûre, Fragoletta de Latouche (voir l'article correspondant) où sont décrites les amours de Lady Hamilton et de Marie Caroline, reine de Naples. Une nouvelle, Gamiani, attribuée à Alfred de Musset et publiée en 1833 à Bruxelles, circule sous le manteau. Ce petit texte relate l’histoire des amours saphiques d’une belle et riche comtesse d’origine italienne. Balzac éprouve une forte admiration pour George Sand qui entretient à partir de 1832 une relation amicalement amoureuse avec la comédienne Marie Dorval. La princesse Belgiojoso, à la nature de feu et « aux yeux de gazelle », ne fait pas mystère de ses amours lesbiennes. Milanaise réfugiée à Paris depuis 1831, son salon accueillait les célébrités du monde des arts. Peinte par Chassériau, Lehmann et Francesco Hayez, elle servit, selon le balzacien Pierre Barbéris, de modèle pour un personnage (Mme de San Réal) de La fille aux yeux d’or. Malgré son allure maladive, la princesse était avec George Sand et Delphine de Girardin, l’une des trois reines du Paris des années 1830-1850. Alfred de Musset, prétendant éconduit, écrivit pour se venger un poème intitulé La Morte, et contribua au succès du bon mot qui courait sur elle : « elle a dû être bien de son vivant. » Le journaliste Arsène Houssaye, fin observateur de son époque, ami de tous, raconte dans ses Confessions le détail de certaines de ces amours. Et révèle de noms de femmes aimant les femmes. D’autres projets de Balzac qui devaient traiter de ce sujet n’ont jamais vu le jour. Balzac publie en 1830 Une passion dans le désert, une nouvelle où il parle de l’amour d’une panthère pour un soldat et Sarrasine qui raconte l’histoire amoureuse d’un castrat à la beauté fatale. La Fille aux yeux d’or intéressera le cinéma. Un film a été tiré du roman par Jean Gabriel Albicoco avec Marie Laforêt dans le rôle sulfureux de Paquita Valdès.
Comme toujours, comme souvent, Balzac débute son récit par une évocation qui semble détachée du sujet qu’il nous promet de développer. Ainsi, les premières pages, magnifiques et terriblement réalistes, de La Fille aux yeux d’or nous montrent le mouvement incessant « de la population parisienne, peuple horrible à voir, hâve, jaune, tanné. » Paris, qui n’a pas été « nommé un enfer » par plaisanterie, ressemble « à un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêts… Là, tout fume, tout brûle, tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s’éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume. » Une ville en constante combustion, en constante fusion. Tous les personnages qui s’y agitent « n’ont pas des visages mais des masques, masques de faiblesse, masques de force, masques de misère, masques de joie, masques d'hypocrisie; tous exténués, tous empreints des signes ineffaçables d’une haletante avidité. » Ils sont en quête « de la gloire qui est un plaisir, ou des amours qui veulent de l’or. » Et cette vaste et exténuante agitation, cette âpre course au gain ou au plaisir, se déploie dans une ville immonde où l’œil du narrateur discerne : « Une peste, pour ainsi dire sous-jacente, qui constamment agit sur les visages du portier, du boutiquier, de l’ouvrier; [il signale aussi] une délétère influence dont la corruption égale celle des administrateurs parisiens qui la laissent complaisamment subsister ! Si l’air des maisons où vivent la plupart des bourgeois est infect, si l’atmosphère des rues crache des miasmes cruels en des arrière-boutiques où se raréfie, sachez qu’outre cette pestilence, les quarante mille maisons de cette grande ville baignent leurs pieds en des immondices que le pouvoir n’a pas encore voulu sérieusement enceindre de murs en béton qui pussent empêcher la plus fétide boue de filtrer à travers le sol, d’y empoisonner les puits et de continuer souterrainement à Lutèce son nom célèbre. La moitié de Paris couche dans les exhalaisons putrides des cours, des rues et des basses oeuvres. » Après cette sombre évocation de la ville, donnant pour ainsi dire les raisons objectives pour lesquelles l’aspect de ces individus est si repoussant, Balzac s’attèle à décrire ceux qui y habitent. Il identifie cinq cercles, cinq sphères distinctes de Parisiens qui, dit-il, attendent leur Dante. Il procède alors à une peinture des prototypes de chacun de ces cercles en commençant par l’examen « du monde qui n’a rien. » 1 - Ce premier cercle est celui de l’ouvrier, du prolétaire, « l’homme qui remue ses pieds, ses mains, sa langue, son dos, son seul bras, ses cinq doigts pour vivre, [qui] attelle sa femme à quelque machine, use son enfant et le cloue à un rouage. » C’est lui, cet ouvrier invisible et nécessaire, « qui, de ses mains sales, tourne et dore les porcelaines, coud les habits et les robes, amincit le fer, amenuise le bois, tisse l'acier, solidifie le chanvre et le fil, satine les bronzes, festonne le cristal, imite les fleurs, brode la laine, dresse les chevaux, tresse les harnais et les galons, découpe le cuivre, peint les voitures, arrondit les vieux ormeaux, vaporise le coton, souffle les tulles, corrode le diamant, polit les métaux, transforme en feuilles le marbre, lèche les cailloux, toilette la pensée, colore, blanchit et noircît tout… » Cette laborieuse classe qui œuvre tout au bas de l’échelle sociale en s’abrutissant pendant cinq jours et cinq nuits dans toutes sortes de taches se livre, pendant son repos, à la plus vulgaire, la plus coûteuse et « la plus brune » des débauches. Elle dépense en une nuit de beuverie le salaire d’une semaine de travail « dans les cabarets qui font une enceinte de boue à la ville; ceinture de la plus impudique des Vénus, incessamment pliée et dépliée, - où se perd comme au jeu la fortune périodique de ce peuple, aussi féroce au plaisir qu’il est tranquille au travail. » Cette armée de prolétaires imbibée d’eau de vie peut s’enflammer à la moindre étincelle de contestation sociale. S’il n’y avait les cabarets pour épuiser ces forces toujours frondeuses, Paris serait le théâtre d’une perpétuelle révolution. Balzac chiffre cette « laide et forte nation » à trois cent mille individus, de l’éternelle prostituée à l’homme malheureux, celui qui n’a pas su se hisser au dessus de sa condition.. Ni ouvrier, ni intellectuel, ni commerçant, il n’est rien. L’auteur nous brosse le portrait de l’un d’eux, un écrivain public : « Mais qui se figurera son visage blanc, ridé, rouge aux extrémités, et sa barbe longue? qui verra sa cravate jaunasse en corde, son col de chemise gras, son chapeau tout usé, sa redingote verdâtre, son pantalon piteux, son gilet recroquevillé, son épingle en faux or, ses souliers crottés, dont les rubans avaient barboté dans la boue? qui le comprendra dans toute l'immensité de sa misère présente et passée? Qui? le Parisien seulement. L’homme malheureux de Paris est l’homme malheureux complet. » Mais, nous dit l’auteur le hasard peut faire sortir de ce peuple qui semble indéfiniment condamné à son état d’infériorité « un ouvrier économe, gratifié d’une pensée, il a pu jeter les yeux sur l’avenir, il a rencontré une femme, il s’est trouvé père, et après quelques années de privations dures il entreprend un petit commerce de mercerie, loue une boutique. Si ni la maladie ni le vice ne l’arrêtent en sa voie, s’il a prospéré, il deviendra « un irréprochable cumulard. » Cet homme énergique, travailleur, à l’esprit gaulois est indispensable à la France, il la fait en réalité, car c’est lui qui la renouvelle, démographiquement parlant, et c’est lui qui produit ses richesses. « Saluez, demande l’auteur, ce roi du mouvement parisien qui s’est soumis le temps et l’espace. Oui, saluez cette créature composée de salpêtre et de gaz qui donne des enfants à la France pendant ses nuits laborieuses, et remultiplie pendant le jour son individu pour le service, la gloire et le plaisir de ses concitoyens. Cet homme résout le problème de suffire, à la fois, à une femme aimable, à son ménage, au Constitutionnel, à son bureau, à la Garde nationale, à l'Opéra, à Dieu… » Balzac nous donne l’emploi du temps de ce qu’il appelle « la vie normale » de ce petit miracle entreprenant et patriote. Levé à cinq heures, « qu'il vente ou tonne, pleuve ou neige », il distribue Le Constitutionnel, journal libéral qui lui a donné, une fois pour toutes, sa pensée patriotique et ses convictions politiques. Il est de cette « chair de citoyen » dont on fait de la « chair à canon. » A neuf heures, il est chez lui, avec sa femme qu’il taquine et ses enfants qu’il gronde ou embrasse selon son humeur. A dix heures moins le quart il est à la mairie où il occupe un emploi à l’état civil, notant les naissances et les décès de son arrondissement. A quatre heures il est dans sa boutique de mercerie où, « en homme d’action », il lutine les demoiselles de comptoir « dont les yeux vifs attirent force chalands. » A six heures, il est tous les deux jours figurant à l’Opéra. A minuit il redevient "bon mari, homme, tendre père, il se glisse dans le lit conjugal, l’imagination encore tendue par les formes décevantes des nymphes de l’Opéra, et fait ainsi tourner, au profit de l’amour conjugal, les dépravations du monde et les voluptueux ronds de jambe de la Taglioni." Cet homme, conclut Balzac « résume tout : histoire, littérature, politique, gouvernement, religion, art militaire. » En lui tout est jambes. C’est la France qui marche. 2 - La seconde sphère parisienne est celle du petits bourgeois, qui vit, « mais crétinisé. » On le rencontre « la face usée, plate, vieille, sans lueur aux yeux, sans fermeté dans la jambe, se traînant d’un air hébété sur le boulevard, la ceinture de sa Vénus, de sa ville chérie. » Sans en avoir l’air, Balzac rejoint par l’allusion à la ceinture de la déesse le champ de la grande peinture. Que veut cet homme ? demande le narrateur. La reconnaissance et la possibilité de profiter tranquillement de son argent. Sa barrière à lui, nous précise-t-on, c’est le restaurateur à la mode où il s’empoisonne à force de vin choisi et de plats riches ou alors, plus bourgeoisement, « le bal de famille où l’on étouffe jusqu’à minuit. » Le couple qu’il forme avec sa femme est un couple actif, tous deux participent à la fortune du ménage. « Madame est là dès le matin, elle est factrice aux halles et gagne à ce métier douze mille francs par an, dit-on. Monsieur, quand madame se lève, passe dans un sombre cabinet, où il prête à la petite semaine, aux commerçants du quartier. A dix heures, il se rend au ministère où il occupe un poste de chef de bureau. Il représente, dit Balzac, « ces prix d’excellence sociaux » qui infestent l’administration. 3 - Le troisième cercle social représente un sorte de « ventre parisien, où se digèrent les intérêts de la ville et où ils se condensent sous la forme dite affaires » où se remue et s’agite, par un âcre et fielleux mouvement intestinal, « la foule des avoués, médecins, notaires, avocats, gens d’affaires, banquiers, gros commerçants, spéculateurs, magistrats. » Tous vivent en « d’infectes études, en des salles d’audiences empestées, dans de petits cabinets grillés » et passent le jour « courbés sous le poids des affaires, se lèvent dès l’aurore pour être en mesure, pour ne pas se laisser dévaliser, pour tout gagner ou pour ne rien perdre, pour saisir un homme ou son argent, pour emmancher ou démancher une affaire, pour tirer parti d’une circonstance fugitive, pour faire pendre ou acquitter un homme. » Ces hommes vivent avec le sentiment qu’ils n’ont jamais le temps et désespèrent de ne pouvoir « ni l’étendre, ni le resserrer. » Ils savent tout du monde. « Pour eux, point de mystères, ils voient l’envers de la société dont ils sont les confesseurs. » Et cette société, ils la méprisent. Ainsi, à Paris où « il n’y a de vrai parent que le billet de mille francs, d’autre ami que le Mont-de-piété », à toute heure, indifférents aux drames qu’ils provoquent, « l’homme d’argent pèse les vivants, l’homme des contrats pèse les morts, l’homme de loi pèse la conscience. » Après ces journées où ils sont descendus « au fond des peines qui poignent les familles », ils sont le soir « requis d’aller au bal, à l'Opéra, dans les fêtes où ils vont se faire des clients, des connaissances, des protecteurs. Tous mangent démesurément, jouent, et leurs figures s’arrondissent, s’aplatissent, se rougissent. » Balzac prédit à ces magistrats, avocats, banquiers ou grands commerçants plusieurs fins de carrières possibles. « Le type de cette classe serait soit le bourgeois ambitieux, qui, après une vie d’angoisses et de manœuvres continuelles, passe au Conseil d’Etat comme une fourmi passe par une fente; soit quelque rédacteur de journal, roué d’intrigues, que le Roi fait pair de France, peut-être pour se venger de la noblesse; soit quelque notaire devenu maire de son arrondissement, tous gens laminés par les affaires et qui, s’ils arrivent à leur but, y arrivent tués. » 4 - Le monde artiste est celui qui arrive en quatrième position. Balzac sait de quoi il parle. Il en vient, il en est. Il s’étend sur le travail prométhéen qu’exige l’art, non parce qu’il est art mais parce qu’en ce siècle de démocratie où les valeurs anciennes sont remises en question, la « concurrence, les rivalités, les calomnies assassinent ces talents » et qu’en plus les créanciers ne reconnaissent que le talent qui a réussi. Il sait à quel point il est vain et dangereux de chercher « à concilier le monde et la gloire, l’argent et l’art. » Les artistes, poussés par le besoin de créer malgré tout, arborent le plus souvent des « visages brisés, fatigués, sinueux... » Les uns versent dans le vice, les autres meurent jeunes et ignorés. Mais ce qui les détruit, c’est la passion. Et à Paris, la passion se « résout par deux termes : or et plaisir. » 5 - La cinquième sphère, au haut de la pyramide sociale, se distingue par une sorte d’extension de l’espace, de facilité naturelle à occuper des lieux qui exclut toute promiscuité et où règne l’oisiveté, le suprême luxe, érigée en art de vivre. Autant les quatre sphères précédentes semblent étouffer par un manque chronique d’air, autant celle-ci semble en disposer à profusion. Nous atteignons avec elle le sommet. Balzac le dit : « Maintenant, ne respirez-vous pas? Ne sentez-vous pas l’air et l’espace purifiés ? Ici, ni travaux ni peines. La tournoyante volute de l’or a gagné les sommités. » Et il ajoute avec ce réalisme narquois, politiquement surprenant venant d’un écrivain qui se pose en défenseur des vérités éternelles que sont, selon lui, la religion et la monarchie, le constat de l’inopérante, inféconde et partant injuste primauté de la noblesse dans l’échiquier politique de son époque. Il reconnaît le raffinement de son luxe et admire ses manières mais il regrette son impuissance à reprendre la direction du pays et, surtout me semble-t-il, l’irréversible extinction de sa lignée. « Mais abordons les grands salons aérés et dorés, les hôtels à jardins, le monde riche, oisif, heureux, renté. Les figures y sont étiolées et rongées par la vanité. Là rien de réel. Chercher le plaisir, n’est-ce pas trouver l’ennui? Les gens du monde ont de bonne heure fourbu leur nature. N’étant occupés qu’à se fabriquer de la joie, ils ont promptement abusé leurs sens, comme l’ouvrier abuse de l’eau-de-vie. » Balzac rappelle pour expliquer le délabrement physique de ce monde que « le plaisir est comme certaines substances médicales : pour obtenir constamment les mêmes effets, il faut doubler les doses, et la mort ou l'abrutissement est contenu dans la dernière. » Et si les classes inférieures singent les grands dans leurs comportements, leurs costumes, leurs langages et jusqu’à leurs vices, la bourgeoisie, par son énergie et son intelligence pratique, a su avec son capital confisquer à ces pantins pathétiques la réalité du pouvoir. Chez les nobles, dit Balzac, « règne l’impuissance. Là plus d’idées, elles ont passé comme l’énergie dans les simagrées du boudoir, dans les singeries féminines. Il y a des blancs-becs de quarante ans, de vieux docteurs de seize ans. » Dans ce monde de dédain et d’indifférence les « embrassades couvrent une profond indifférence, et la politesse un mépris continuel. On n’y aime jamais autrui. » A l’inverse des classes nerveuses et productives qui ne se suffisent pas des vingt quatre heures par jour, ici « on y est avare de temps à force d’en perdre. » « Ces malheureux Heureux » mènent une vie creuse, « dans l’attente continuelle d’un plaisir qui n’arrive jamais. » Ils sont dans un « cet ennui permanent, cette inanité d’esprit, de cœur et de cervelle, cette lassitude du grand raout parisien » qui se reproduisent sur les traits, et leur « confectionnent ces visages de carton, ces rides prématurées, cette physionomie des riches où grimace l’impuissance, où se reflète l’or, et d’où l’intelligence à fui. » Ces cinq cercles vivent dans 40000 maisons faisant de Paris, par son développement démographique qui ne cesse d’augmenter à partir de cette période, « un vaste atelier de jouissances. »
Henry de Marsay, « le roi des dandies » comme le qualifie Lousteau dans Splendeur et misère des Courtisanes, remarque un jour qu’il se promène sur la terrasse des Feuillants, située près du Louvre, une étrange jeune femme à l’extraordinaire beauté. Ce lieu de promenade est fréquenté par les jeunes gens de la bonne société, cette espèce de flâneurs qui sont « les seuls gens réellement heureux à Paris, et qui en dégustent à chaque heure les mouvantes poésie. » De Marsay revoit cette jeune femme le lendemain, un vendredi, surveillée de si près par sa gardienne qu’on avait l’impression que « les deux femmes étaient cousues ensemble. » A la vue d’Henry cette jeune femme ne peut réprimer un mouvement de surprise qui l’intrigue malgré « le magnétisme animal » qu’il sait exercer sur certaines femmes. Il semblait, dit-il à son ami Paul de Manerville, qu’elle voulait se jeter à son cou. Elle n’apparaît pas le samedi, mais revient le dimanche à la satisfaction de de Marsay qui veut non seulement la revoir mais lui parler, et plus bien entendu, la posséder, puisque entre eux, manifestement, affinité il y a. Connaissant les usages du monde, il doute cependant de la qualité sociale de la promeneuse, car pour lui « une femme qui vient aux Tuileries le dimanche n’a pas de valeur, aristocratiquement parlant. » Il la décrit, encore ému par cette rencontre nonobstant sa déjà longue et fructueuse carrière de séducteur blasé. « Ah! mon cher, physiquement parlant, l’inconnue est la personne la plus adorablement femme que j’aie jamais rencontrée Elle appartient à cette variété féminine que les Romains nommaient fulva flava, la femme de feu. Et d’abord, ce qui m’a le plus frappé, ce dont je suis encore épris, ce sont deux yeux jaunes comme ceux des tigres; un jaune d’or qui brille, de l’or vivant, de l’or qui pense, de l’or qui aime et veut absolument venir dans votre gousset ! … Cette fille semblable à une chatte qui veut venir frôler vos jambes, une fille blanche à cheveux cendrés, délicate en apparence, mais qui doit avoir des fils cotonneux sur la troisième phalange de ses doigts; et le long des joues un duvet blanc dont la ligne, lumineuse par un beau jour, commence aux oreilles et se perd sur le col. » Elle idéalise pour lui La femme caressant sa chimère, une peinture délirante et suggestive, qu’il apprécie énormément car « elle est la plus chaude, la plus infernale inspiration du génie artistique par ses formes ardentes et voluptueuses. » Cette œuvre, que connaissait bien Balzac, représente une femme caressant amoureusement un « monstre aux ailes de colombe et aux nageoires de poisson », ce qui nous conduit au tableau de Delacroix, La Femme caressant son perroquet. Cette inconnue, La Fille aux yeux d’or, a déjà été remarquée en compagnie d’une autre femme lui apprend son ami Paul, lui aussi riche et désœuvré. Cette autre femme, qui l’a fortement impressionné, est ainsi décrite : « Elle a des yeux noirs qui n’ont jamais pleuré, mais qui brûlent ; des sourcils noirs qui se rejoignent et lui donnent un air de dureté démentie par le réseau de ses lèvres, sur lesquelles un baiser ne reste pas, des lèvres ardentes et fraîches; un teint mauresque auquel un homme se chauffe comme au soleil. » Paul se rend compte alors d’un fait étonnant : « mais, ma parole d’honneur, elle te ressemble... » Intrigué et flatté, de Marsay retourne sur la terrasse des Feuillants, en attente. Il la revoit. Elle a le même comportement que les fois précédentes : cela le confirme dans le sentiment qu’il ne la laisse pas indifférente. Fouetté par la sensualité animale qui se dégage d’elle il se dit : « J’aurai décidément cette fille comme maîtresse. »
Un geste de la mystérieuse jeune femme, quand il la croise, lui fait comprendre qu’elle le veut aussi. Le frôlant, elle lui serre furtivement la main. Puis elle disparaît entraînée par sa duègne vers « la grille de la rue Castiglione », ajoutant du mystère à cette étrange rencontre. « Les deux amis suivirent la jeune fille en admirant la torsion magnifique de ce cou auquel la tête se joignait par une combinaison de lignes vigoureuses, et d’où se relevaient avec force quelques rouleaux de petits cheveux. La fille aux yeux d’or avait ce pied bien attaché, mince, recourbé, qui offre tant d'attraits aux imaginations friandes. Aussi était-elle élégamment chaussée, et portait-elle une robe courte. » Dans la voiture qui l’emporte, elle agite son mouchoir en « se moquant du qu’en dira-t-on », disant publiquement à Henry de la suivre. Laissant en plan son ami, ressentant le même trouble que la jeune femme, il demande au cocher d’un fiacre de suivre discrètement la voiture de La Fille aux yeux d’or qui rentre un peu plus tard dans l’un des plus beaux hôtels de la rue Saint Lazare, la maison du marquis de San Réal. De Marsay connaissant les règles élémentaires de la filature amoureuse poursuit son chemin songeant de toute évidence que la jeune femme est la maîtresse du grand seigneur espagnol, le propriétaire de l’hôtel où les deux femmes sont entrées. Le lendemain, de Marsay dépêche dans le quartier son domestique Laurent, « un garçon rusé », déguisé en Auvergnat, pour s’informer. Il interroge le facteur, répondant du nom de Moinot (« mon nom s’écrit absolument comme un moineau : M-o-i-n-o-t, not, Moinot » dit l’homme de lettres), et l’on apprend que l’hôtel appartient au marquis de San Réal. Contre un bon repas et quelques pièces d’or, il apprend également le nom de La Fille aux yeux d’or écrit sur un paquet venant de Londres et qui doit lui être remis. Le repas composé d’un filet sauté aux champignons, précédé de quelques douzaines d’huîtres et arrosé d’une bouteille de Chablis est pris à neuf heures trente au Puits sans vin, restaurant dont le nom est, comme on le voit, un rébus. Là, le domestique d´Henry se fait décrire l’hôtel. Selon le facteur, il est inviolable tant il est protégé par ses portes mystérieuses et compliquées. Personne ne peut y pénétrer sans un mot de passe. De plus un personnel expérimenté, qui n’entend pas le français, surveille tous ceux qui se présentent comme s’il s’agissait de criminels. Personne ne connaît la couleur de la parole des gens qui y vivent. Enfin, dit le facteur, « l’hôtel a été choisi exprès entre cour et jardin pour éviter toute communication avec d’autres maisons. » Balzac nous décrit, en plein cœur de Paris, un lieu aussi impénétrable qu’un sérail d’orient.
De Marsay n’est pas un héros ordinaire. Il a hérité, d’une mère magnifique et d’un père qui ne l’était pas moins, d’un physique et d’une prestance native exceptionnelle. Il est grand, il a les yeux bleus de son père anglais, lord Dudley. C’est « un enfant de l’amour », un Adonis dont les femmes raffolaient au premier regard posé sur lui. De Marsay, élevé en France loin de son géniteur dont on peut douter qu’il sache même le nom, nous dit Balzac, (« les pères n’aiment-ils que leurs enfants avec lesquels ils ont fait une ample connaissance ? »), et d’une mère, jeune, belle esseulée qui, loin de son amant resté en Angleterre, se remarie à un marquis après l’avoir été à un vieil aristocrate qui lui a vendu son nom : de Marsay - confirmant l’adage selon lequel « la fidélité quand même n’était pas et ne sera guère de mode à Paris. » Ce rapide survol de l’enfance de de Marsay nous montre l’absence totale d’affection familiale dans laquelle il a grandi et explique sans doute son cynisme froid en matière de relations humaines. Entre-temps, son père dont l’activité de séducteur ne cesse pas, fera un autre enfant, une fille prénommée Euphémie, à une maîtresse espagnole qui vit dans les îles, à Cuba sans doute, car il sera question au cours du récit de la Havane, la ville dont serait originaire Paquita Valdès. La fille de lord Dudley est ramenée à Madrid avec une jeune créole des Antilles. Il se trouve qu’Euphémie a les « goûts ruineux des colonies » et ses moeurs particulières, elle épouse un Grand d’Espagne, le marquis de San Réal, un vieillard « puissamment riche » qui la laisse libre de ses actes. A cette époque la France occupait l’Espagne. Le marquis avait décidé de s’installer à Paris, dans un hôtel particulier de la rue Saint Lazare. Lord Dudley ne prit jamais la peine de prévenir ses enfants de leurs existences respectives. De Marsay, garçon, fera l’objet d’une attention soutenue, efficace et désintéressée de la part d’un prêtre profondément politique, l’abbé Maronis, qui finira ses jours évêque. Cet « abbé sans sous ni maille » lui apprend en trois ans ce qu’on apprend en dix ans au collège : pour ce faire il tient son élève soigneusement éloigné des églises et, pour lui faire connaître les coulisses du monde, il l’emmène se frotter au savoir-faire des courtisanes. L’abbé Maronis lui fait étudier la civilisation sous toutes ses faces, puis il lui démonta les sentiments humains en lui enseignant la politique. Il tire de cet enseignement que la vie est plus compliquée et « plus difficile que la diplomatie. » A la fin de cet apprentissage, de ces longues années de formation, Henry échappant à « la stupide juridiction de la masse (…) ne croyait ni aux hommes, ni aux femmes, ni à Dieu, ni au Diable. » Afin de parachever sa formation intellectuelle, l’abbé l’initie au maniement des armes : il sait tirer au pistolet, il sait se battre à l’épée. Il sait monter à cheval et conduire élégamment une voiture. Il sait jouer au piano et possède une voix magnifique. L’abbé le présente à certaines connaissances dans la haute société parisienne ce qui équivalait à cent milles livres de rente supplémentaires. Jeune homme, Henry de Marsay vivait la « jeunesse dorée » de ceux qui ne montrent rien, « se moquent de tout et s’habillent, dînent, dansent le jour de la bataille de Waterloo, pendant le choléra ou pendant une révolution. » Il est un membre influent d’un groupe connu sous le nom des Treize, qui donne le titre général aux trois nouvelles qui composent l’Histoire des Treize. Ces treize sont « des rois inconnus, mais réellement rois, et plus que rois, des juges et des bourreaux... » Ils forment une société secrète, une organisation efficace et puissante dont la religion, dit Balzac, est faite « de plaisirs et d’égoïsmes. » Les membres de cette organisation défendent non des convictions, mais des passions et des intérêts. Ils n’ont sur terre « aucun sentiment obligatoire » et font montre d’une misogynie partagée. Ainsi de Marsay se demande : « qu’est-ce que la femme ? une petite chose, un ensemble de niaiseries » rejoignant Vautrin, qui préfère les jolis garçons et méprise cet « être inférieur qui obéit trop à ses organes. » Enfin, et pour avoir une idée plus complète du personnage qu’incarne Henry de Marsay, Balzac nous apprend qu’il se réclame du profond politique qu'était Talleyrand. Il « sera ce qu’il voudra être » dit de lui l’un de ses amis.
Les Treize sont des hommes de pouvoir et de ressource, ils connaissent tout de Paris : à la demande de de Marsay, ils rechercheront et retrouveront la trace de la belle inconnue dont nous savons maintenant qu’elle se nomme Paquita Valdès, mais son origine reste incertaine. Est-elle Maure ? Est-elle espagnole ? Balzac ne tranche pas. Il la définit ainsi : « Cette belle créature tenait aux houris de l’Asie par sa mère, à l’Europe par son éducation, aux tropiques par sa naissance. » Elle est surtout une sorte de résumé vivant de l’idéal sexuel de l’Orient. Après maintes démarches, de Marsay réussit à communiquer avec Paquita grâce à un compliqué échange de lettres et un rendez-vous est pris. Balzac a recours dans cette partie du récit à une situation exposée dans les Mille et une nuits et qu’il exploite.
La première visite de de Marsay à Paquita s’effectue la nuit. Une voiture l’attendait sur le trottoir à dix heures trente du soir. Elle l’emporte à travers Paris sans savoir où il allait. On le fait pénétrer dans un appartement sans lumière, humide et nauséabond et dont les pièces étaient presque vides. Cette atmosphère bizarre fait qu’Henry a le sentiment de pénétrer dans un roman d’Ann Radcliff. Une très vieille femme, laide et silencieuse, se chauffe au feu de la cheminée. Tout semblait frigorifié dans ce lieu lugubre jusqu’au moment où il aperçoit la jeune fille qui l’attendait. « Ce salon, cette vieille femme, ce foyer froid, tout eût glacé l’amour, si Paquita n’avait pas été là sur une causeuse dans un voluptueux peignoir, libre de jeter ses regards d’or et de flamme, libre de montrer son pied recourbé, libre de ses mouvements lumineux. » Cette première rencontre, à l’image « du tremblement d’un certain regard », est intense, fragile et passionnément maladroite dans l’extrême désir qui les travaille. Le salon s’en trouve transformé, tout illuminé du bonheur de Paquita, heureuse d’aimer, heureuse d’être aimée. « L’Espagnole profitait de ce moment de stupeur pour se laisser aller à l'extase de cette adoration infinie le cœur d’une femme quand elle aime véritablement et qu’elle se trouve en présence d’une idole vraiment espérée. Ses yeux étaient tout joie, tout bonheur, et il s’en échappait des étincelles. Elle était sous le charme, et s’enivrait sans crainte d’une félicité longtemps rêvée. » Etonné par l’insolite présence de la vieille femme dans cette chambre d’amour, il demande qui elle est à Paquita. Elle lui répond : « C’est la seule femme à laquelle je puisse me fier, quoiqu’elle m’ait déjà vendue, dit Paquita tranquillement. Mon cher Adolphe, c’est ma mère, une esclave achetée en Géorgie pour sa rare beauté, mais dont il reste peu de chose aujourd'hui. Elle ne parle que sa langue maternelle. » De Marsay tombe sous le charme absolu du véritable amour. Il en devient même jaloux et menace sa maîtresse de toute infidélité. Le regard, l’ardeur, l’expression, la voix de de Marsay surprennent, à l’étonnement de celui-ci, et la mère et la fille tant il leur semble familier. De retour chez lui, Henry, naviguant « comme ivre » entre ciel et enfer, songe à l’étrangeté de ce rendez-vous. « Un seul baiser avait suffi. Aucun rendez-vous ne s’était passé d’une manière plus décente, ni plus chaste, ni plus froide peut-être, dans un lieu plus horrible par les détails, devant une plus hideuse divinité ; car cette mère était restée dans l’imagination d’Henri comme quelque chose d’infernal, d’accroupi, de cadavéreux, de vicieux, de sauvagement féroce, que la fantaisie des peintres et des poètes n’avait pas encore deviné. En effet, jamais rendez-vous n’avait plus irrité ses sens, n’avait révélé de voluptés plus hardies, n’avait mieux fait jaillir l’amour de son centre pour se répandre comme une atmosphère autour d’un homme. Ce fut quelque chose de sombre, de mystérieux, de doux, de tendre, de contraint et d'expansif, un accouplement de l’horrible et du céleste… » Il rêva de Paquita. Ce furent des rêves passionnés, mystérieux et bizarres comme si un voile changeait la perception des choses. De Marsay consacra les deux jours qui le séparaient de sa seconde rencontre avec Paquita au démon « dont il tenait sa puissance » de despote oriental, c’est à dire qu’il continua à se renseigner au sujet de la vie de sa maîtresse.
Pour la seconde nuit, la procédure change totalement. Henry doit se laisser bander les yeux, ce qu’il accepte à contre cœur : il est littéralement enlevé et transporté en voiture aveugle à travers Paris vers le lieu inconnu où l’attend Paquita. Il essaie de se repérer par le bruit que font les roues sur le pavé et le nombre de ruisseaux traversés. Mais il est si excité et si en colère que son attention s’en trouve amoindrie. Au bout d’une demi heure de course - il a été pris sur le boulevard Montmartre - la voiture s’arrête. Comme une femme dans sa litière, c’est sur un brancard qu’il franchit un jardin dont « il sentit les fleurs et l’odeur particulière aux arbres et à la verdure », essayant de reconnaître les essences, dans un silence profond. Il y eut ensuite des marches d’escalier, des couloirs, puis « une chambre parfumée. » C’est toujours voilé qu’il s’avance vers elle, puis poussé sur un divan, des mains amoureuses lui enlèvent le foulard qui l’aveuglait. Henri vit alors « Paquita dans sa gloire de femme voluptueuse. » Elle se tenait « au milieu d’une vaporeuse atmosphère chargée de parfums exquis, vêtue d’un peignoir blanc, les pieds nus, des fleurs d’oranger dans ses cheveux noirs… » Ses cheveux cendrés au jour sont devenus noirs soulignant peut être le thème où s’oppose le dehors et le dedans, le clair et le sombre, l’autre et le même pour aboutir à la dualité androgyne, l’homme et la femme ensemble, que Balzac développera dans Séraphita (1835). On pourrait également revenir à l’idée d’un Balzac utilisant les mots comme de la peinture et d’imaginer sa parfaite connaissance des effets de lumière sur les couleurs. Théophile Gautier écrit à propos d’un portrait de Mme Sabatier, la fameuse Présidente qu’aima et détesta Baudelaire, exposé par Gustave Ricard au Salon de 1850 : « ses beaux cheveux, bruns lorsqu'ils sont lustrés d’ombre, dorés lorsqu'ils pétillent dans un clair rayon, jouent légèrement sur son front comme soulevés par un souffle amoureux. » Le boudoir où Paquita se tient est d’un luxe magnifique, bien entendu oriental où le blanc, le rouge, l’or, le noir dominent. Au milieu de cet espace s’étale un véritable divan turc « c'est-à-dire un matelas posé par terre, mais un matelas large comme un lit, un divan de cinquante pieds de tour » en cachemire blanc relevé par de la soie noire et des coussins qui l’enrichissaient encore par le goût de leurs agréments. Les murs sont tendus d’une étoffe rouge et de la mousseline des Indes protégeaient les fenêtres que rehaussait du rose « couleur amoureuse. » Les tapis, les meubles, la pendule, les candélabres en marbre blanc et or, les jardinières contenant des fleurs blanches ou rouges : tout avait « été l’objet d’un soin pris avec amour. » Pour l’auteur : « L’âme a je ne sais quel attachement pour le blanc, l’amour se plaît dans le rouge, et l’or flatte les passions, il a la puissance de réaliser leurs fantaisies. » Ce soin et cet amour dont avait été l’objet ce boudoir, nous le savons, c’est Balzac lui-même qui l’avait pris pour arranger son appartement. Balzac décrit en fait, dans ce passage, le boudoir de son domicile secret, « une cellule inabordable », 13, rue des Batailles - actuellement place d’Iéna - à Chaillot. Revenons à l’histoire. Avec l’hôtel de San Réal où vit Paquita et où se trouve de Marsay, Balzac pose au cœur de Paris un lieu qui en incarne intensément ses désirs. Lieu fermé, discret, lieu de nuit que l’on ne peut pas franchir sans mot de passe – lieu étrange qui le rattache à la mythologie du mystère véhiculée par l’idée que l’on se faisait alors de l’Orient. En vérité, au plus secret de la ville, il produit l’image de ses convoitises inavouées, il donne pour accompli ce rêve de plaisir et d’or dont elle vit. Il devient, ce lieu, un Orient dans l’Occident « en ce pays sans mœurs, sans croyance, sans aucun sentiment. » Cette retraite, nous apprend Paquita, « a été construite pour l’amour. Aucun son ne s’en échappe… quelques forts que soient ces cris, ils ne sauraient être entendus au-delà de cette enceinte. On peut y assassiner quelqu’un, ses plaintes seraient vaines comme s’il était seul au milieu du grand désert. » Ceci posé le drame peut se nouer. La jalousie, d’abord, qu’Henry va éprouver devant le mutisme de sa maîtresse concernant le nom de son protecteur. Puis ensuite l’ambiguïté de leur relation : l’étonnement de Paquita la première nuit (« frappant ! frappant ! ») devant la violence d’Henry, les paroles obscures qu’elle laisse échapper, la robe de velours rouge qu’elle demande à son amant de passer avant de faire l’amour, et enfin la surprise de de Marsay lorsqu’il s’aperçoit que Paquita, bien que loin d’être innocente, était vierge. « Tout ce que la volupté la plus raffinée a de plus savant, tout ce que pouvait connaître Henri de cette poésie des sens que l’on nomme l’amour, fut dépassé par les trésors que déroula cette fille dont les yeux jaillissants ne mentirent à aucune des promesses qu’ils faisaient. Ce fut un poème oriental, où rayonnait le soleil que Saadi, Hafiz ont mis dans leurs bondissantes strophes. Seulement, ni le rythme de Saadi, ni celui de Pindare n’auraient exprimé l’extase pleine de confusion et la stupeur dont cette délicieuse fille fut saisie quand cessa l’erreur dans laquelle une main de fer la faisait vivre. » Henry, « gorgé de plaisir » par sa nuit dans les bras de Paquita, se retrouve au petit matin sur le boulevard. Pour saluer le jour nouveau : « il tira deux cigares de sa poche, en alluma un à la lanterne d’une bonne femme qui vendait de l’eau-de-vie et du café aux ouvriers, aux gamins, aux maraîchers, à toute cette population parisienne qui commence sa vie avant le jour; puis il s’en alla. » De retour chez lui il s’endormit du sommeil « des mauvais sujets » qui est, nous dit Balzac, aussi profond que celui de l’innocence car « les extrêmes se touchent. »
Un certain temps passe avant que de Marsay revoit Paquita. Le jour de leur rendez-vous, il déjeune d’œufs au thon et d’huîtres. Son ami Paul l’accompagne. De Marsay lui développe son idée de la femme écran, celle que l’on montre pour cacher celle que l’on aime et respecte. Tout en parlant il repense à son aventure et comprend l’étrange situation dans laquelle il s’est mis. « En ce moment donc, de Marsay s’aperçut qu’il avait été joué par la Fille aux yeux d'or, en voyant dans son ensemble cette nuit dont les plaisirs n’avaient que graduellement ruisselé pour finir par s’épancher à torrents. Il put alors lire dans cette page si brillante d’effet, en deviner le sens caché. L’innocence purement physique de Paquita, l’étonnement de sa joie, quelques mots d’abord obscurs et maintenant clairs, échappés au milieu de la joie, tout lui prouva qu'il avait posé pour une autre personne. Comme aucune des corruptions sociales ne lui était inconnue, qu’il professait au sujet de tous les caprices une parfaite indifférence, et les croyait justifiés par cela même qu’ils se pouvaient satisfaire, il ne s’effaroucha pas du vice, il le connaissait comme on connaît un ami, mais il fut blessé de lui avoir servi de pâture. » Le sentiment d’avoir été utilisé par Paquita le décide à se venger. Il doit punir la fautive. Pour se rendre chez Paquita, la même procédure que les précédentes est employée. Sur le boulevard, une voiture le prend et le conduit les yeux bandés dans la chambre parfumée de son amante. Le trajet lui semble être celui qui mène à l’hôtel San Réal, jusqu’à la petite porte du jardin. Paquita est là, toute triste d’avoir beaucoup pleuré. Ce désespoir réel, mêlé au souvenir du plaisir qu’elle lui a donné, distrait Henry de son besoin de vengeance. « La pauvre fille ne ressemblait plus à la curieuse, à l’impatiente, à la bondissante créature qui avait pris de Marsay dans ses ailes pour le transporterdans le septième ciel de l’amour. Il y avait quelque chose de si vrai dans ce désespoir voilé par le plaisir, que le terrible de Marsay sentit en lui-même une admiration pour ce nouveau chef-d'oeuvre de la nature. » Ils refont l’amour, mais sans déguisement. Elle ne veut plus être aimée par une femme mais par lui, l’homme qui lui a fait découvrir le plaisir. Cette troisième nuit est supérieure aux deux autres. La jeune femme « dont le teint chaudement coloré, dont la peau douce, mais légèrement dorée par les reflets du rouge et par l’effusion de je ne sais quelle vapeur d’amour » se révèle exceptionnellement douée pour l’amour. « Paquita semblait avoir été créée pour l’amour, avec un soin spécial de la nature. D’une nuit à l’autre, son génie de femme avait fait les plus rapides progrès. Quelle que fût la puissance de ce jeune homme, et son insouciance en fait de plaisirs, malgré sa satiété de la veille, il trouva dans la Fille aux yeux d’or ce sérail qui sait créer la femme aimante et à laquelle un homme ne renonce jamais. » Parce qu’elle ne sait rien, qu’elle ne connaît que deux hommes, le marquis et son serviteur Christemo, de Marsay est définitivement conquis par cette femme qui est presque, à ses yeux, la femme originelle à qui l’on doit tout apprendre. « Je n’ai rien appris. Depuis l’âge de douze ans je suis enfermée sans avoir vu personne. Je ne sais ni lire ni écrire, je ne parle que l’anglais et l’espagnol. » Il envisage de fuir avec elle et lui propose d’aller « aux Indes, là où le printemps est éternel, où la terre n’a jamais que des fleurs, où l’homme peut déployer l’appareil des souverains, sans qu’on en glose comme dans les sots pays où l’on veut réaliser la plate chimère de l’égalité. Allons dans la contrée où l’on vit au milieu d’un peuple d’esclaves, où le soleil illumine toujours un palais qui reste blanc, où l’on sème des parfums dans l’air, où les oiseaux chantent l’amour, et où l’on meurt quand on ne peut plus aimer... » Paquita lui dit encore sa totale soumission, qu’elle n’est là que pour le servir et répondre à ses moindres désirs, toujours : « Ai-je une volonté? Je ne suis quelque chose hors de toi qu’afin d’être un plaisir pour toi. Si tu veux choisir une retraite digne de nous, l’Asie est le seul pays où l’amour puisse déployer ses ailes... » Mais le destin en décide autrement parce que cette nuit est aussi la nuit du lapsus quand elle prononce, dans son abandon voluptueux, au cœur d’une étreinte, le fatal : « Mariquita ! » qui ne peut s’adresser qu’à une femme. Se sentant trahi et humilié, de Marsay décide immédiatement de la condamner à mort parce que pour lui elle « est d’un pays où les femmes ne sont pas des êtres, mais des choses dont on fait ce qu’on veut, que l’on vent, que l’on achète, que l’on tue, enfin dont on se sert pour ses caprices, comme vous vous servez ici de vos meubles. » Il tente de l’étrangler avec sa cravate. Christemo, qui veille, la sauve de la fureur meurtrière de de Marsay. Mais celui-ci ne sait pas pardonner, il n’est pas de ceux qui pratiquent, dit Balzac, « le savoir-revenir » sur une décision.
La quatrième nuit est celle de la mise à mort. De Marsay, aidé par ses complices, dont Ferragus le chef des dévorants, pénètre dans l’hôtel de San Réal. Ils entendent des bruits de lutte étouffés et sont curieux d’assister à une de ces « querelles de ménage » entre femmes. Ils arrivent trop tard. Dans la lumière des flambeaux allumés, dans le parfum délicat de l’alcôve, la chambre aménagée pour l’amour tout est bouleversé et les mains ensanglantées de Paquita, « disputant une vie » qu’Henry lui avait rendue chère, maculent de leurs empreintes les murs blancs. Son beau corps déchiqueté à coups de poignard par son bourreau gît sur le sol couvert de tapis. « Pour le sang que qu’elle lui a donné, elle lui doit tout le sien » explique le narrateur. L’exécution s’est finalement faite par l’aristocratique Mme de San Réal, l’amante bafouée qui a acheté pour aimer Paquita en « femme des îles. » Cette « Othello femelle », dont on se souvient qu’elle a « un teint mauresque », est aussi impitoyable et cruelle que de Marsay. « La volupté mène à la férocité. » Comprenant qu’elle a été supplantée dans le cœur de son amie elle est rentrée précipitamment de Londres pour constater, furieuse, que son rival est un homme. La remarque de Paul de Manerville, au début de l’histoire, « elle te ressemble » trouve son explication : la marquise de San Réal se révèle être la propre sœur d’Henry - ce qui nous éclaire sur le trouble manifesté par la fille aux yeux d’or à sa vue. Et l’attirance quasi magnétique, et mortelle, de Paquita pour la version masculine de son amante. La fille aux d’or « ce chef d’œuvre de la création » est sans doute facteur d’un inceste inaccompli. Alors qu’elle s’est totalement abandonnée à sa nouvelle passion, elle est condamnée, elle qui n’existe que pour l’amour : « Henri reconnaissait dans Paquita la plus riche organisation que la nature se fût complu à composer pour l’amour », par celui-là même pour qui elle aura pris le risque de mourir. Comme si l’amour était un combat où il n’y aurait que des victimes. Paquita, atrocement lardée de coups de poignard, a le temps avant d’expirer de dire son amour à Henry. Du point de vue pratique, la mère, contre le double de son prix d’achat, se charge de faire disparaître le corps sans vie de sa fille. Quand à la marquise de San Réal, elle ira, dit-elle, expier sa folie dans un couvent en Espagne. A une question sur ce que devenait la jeune femme, Henry de Marsay répond négligemment à son ami Paul : « elle est morte de la poitrine. » Puis il se tourne vers Delphine de Nucingen qui devient sa maîtresse.
Balzac - La Fille aux yeux d'or. "Il se rencontre, dans le monde féminin, de petites peuplades heureuses qui vivent à l'orientale et peuvenet conserver leur beauté."
Balzac - La Fille aux yeux d'or. "Il est impossible à quelque femme que ce soit de surpasser cette fille"
Balzac - La Fille aux yeux d'or. Henry de Marsay : "Quoiqu'il aût vingt-deux ans accompis, il paraissait en avoir à peine dix-sept."
Balzac - La Fille aux yeux d'or. Henry de Marsay rencontre Paquita Valdès (...) sur la terrasse des Feuillants,
Balzac - La Fille aux yeux d'or. Quand l'inconnue et Henri se rencontrèrent de nouveau, la jeune fille le frôla
Balzac - La Fille aux yeux d'or. Henri de Marsay reçoit le messager de Paquita Valdès (...) lui présenta un personnage mystérieux qui voulait absolument lui parler à lui-même.
Balzac - La Fille aux yeux d'or. Henry de Marsay et Paquita Valdèss. Ce fut au milieu d'une vaporeuse atmoisphère chargée de parfums exquis que Paquita
Balzac - La Fille aux yeux d'or. Comment résister aux habiles séductions qui se trament en ce pays?
Balzac - La Fille aux yeux d'or. Henry de Marsay et Paquita Valdès (...) Il trouva dans la Fille aux yeux d'or ce sérail que sait créer la femme aimante
Balzac - La Fille aux yeux d'or. Henry regarda cette fille sans trembler, et ce regard sans peur la combla de joie
Balzac - La Fille aux yeux d'or. Paquita Valdès compte sur ses doigts les douze jours qu'elle et Henri pourront passer ensemble.
Balzac - La Fille aux yeux d'or. La mort de Paquita Valdès (...) son corps, déchiqueté à coups de poignards

/image%2F1270432%2F20221224%2Fob_ddc87d_retour-a-kristel.jpeg)
/image%2F1270432%2F20220303%2Fob_62a985_balzac-la-fille-aux-yeux-d-or-paqui.jpg)