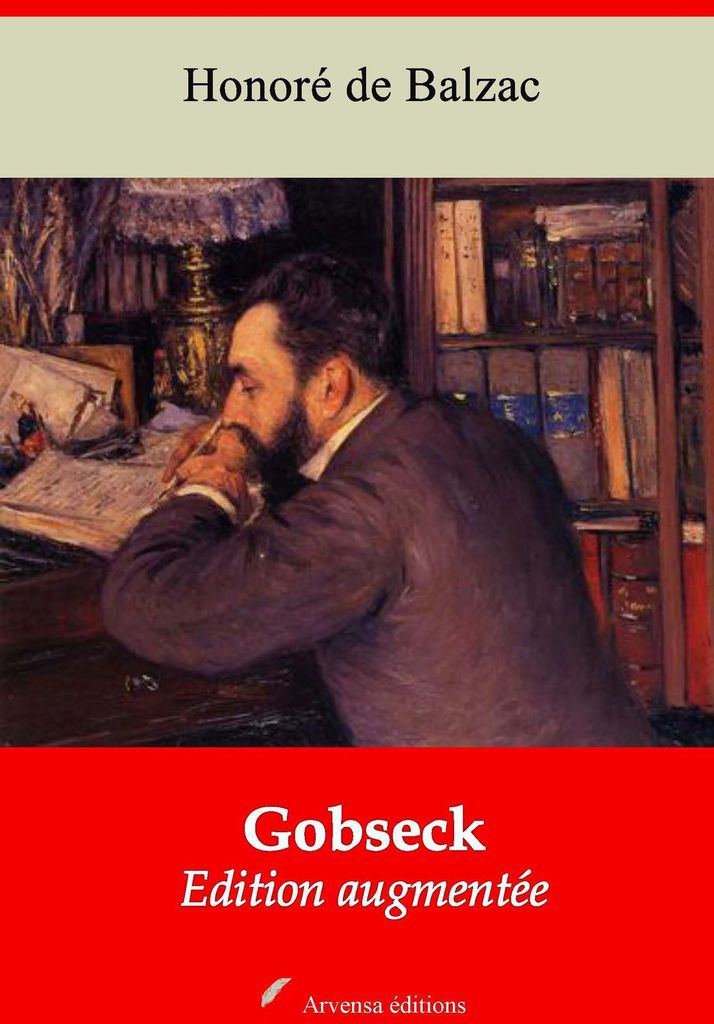L’univers balzacien est fait de corps en manque, de sexe, d'adultère, de mensonges, de trahisons, d'ambition, « de signature qui tue », de luxe, de diamants, de courtisanes splendides, "de Vénus de barrières", de familles ruinées, de vie oisive et de vie suractive. Et de Paris, le cœur du monde balzacien, la ville qui résume toutes les autres, la ville lumière, la ville-enfer fascinante, mortelle et nécessaire comme le péché.
Présentation
L'homme balzacien est un homme enfermé dans ses appétits de puissance, dans ses excès et dans ses passions. Il nous renseigne en historien de la société française sur le faux chic et la vulgarité de ce que la bourgeoisie de 1830, en mal de légitimité, appelle « le bon goût. » Balzac nous montre aussi bien le petit peuple vénal que le bourgeois grossier et l'aristocrate démuni, tous en quête d’argent et de plaisir. « Tout se paie » rappelle Gobseck, qui a donné son nom au titre de l’œuvre. Pour ce maître de la finance clandestine, l’argent doit être, à l’inverse de la religion d’un Grandet qui l'entasse dans sa cave, « en perpétuelle activité », au service des besoins de qui le possède. L’univers balzacien est fait de corps en manque, de sexe, d'adultère, de mensonges, de trahisons, d'ambition, « de signature qui tue », de luxe, de diamants, de courtisanes splendides, "de Vénus de barrières", de familles ruinées, de vie oisive et de vie suractive. Et de Paris, le cœur du monde balzacien, la ville qui résume toutes les autres, la ville lumière, la ville-enfer fascinante, mortelle et nécessaire comme le péché.
L’ère moderne installée définitivement après 1789, engendre de nouveaux modèles de réussite, de nouvelles valeurs, de nouvelles hiérarchies. L’ancien Régime n’est plus. On assiste à l’avènement de l’individu confronté à la dure réalité de la modernité. Suivant le constat de Jean-Jacques Rousseau, Balzac affirme que c’est la vie sociale qui change le caractère des hommes. Jeunes, dit-il, ils sont idéalistes, purs, bons. Adultes ils deviennent indifférents et égoïstes. L’argent et les fêtes données par les nouveaux maîtres - banquiers, commerçants, spéculateurs, propriétaires - corrompent les derniers cercles où s’était réfugié l’esprit de caste de l’aristocratie. La noblesse, désormais ruinée et incapable de réagir, capitule et s’allie à la bourgeoisie en lui vendant ses terres, ses titres et ses enfants.
L’ère moderne installée définitivement après 1789, engendre de nouveaux modèles de réussite, de nouvelles valeurs, de nouvelles hiérarchies. L’ancien Régime n’est plus. On assiste à l’avènement de l’individu confronté à la dure réalité de la modernité. Suivant le constat de Jean-Jacques Rousseau, Balzac affirme que c’est la vie sociale qui change le caractère des hommes. Jeunes, dit-il, ils sont idéalistes, purs, bons. Adultes ils deviennent indifférents et égoïstes. L’argent et les fêtes données par les nouveaux maîtres - banquiers, commerçants, spéculateurs, propriétaires - corrompent les derniers cercles où s’était réfugié l’esprit de caste de l’aristocratie. La noblesse, désormais ruinée et incapable de réagir, capitule et s’allie à la bourgeoisie en lui vendant ses terres, ses titres et ses enfants.
Gobseck ou Les Dangers de l’inconduite
Repères chronologiques
Publié en 1830 avec d’importants rajouts en 1835, Gobseck, premier roman balzacien, est l’une des cellules mères de La Comédie Humaine. Il y est question des lettres de change, de revenus, d’héritage, de drames, de papiers timbrés présentés dans le texte avec une étonnante brutalité. Pour l’auteur, l’histoire secrète des familles, c’est l’histoire des fortunes.
Ce roman révèle en outre des éléments factuels qui nous permettent de le situer dans la temporalité de La Comédie Humaine. Ainsi nous apprenons que Gobseck est né vers 1740 - il est majeur, dit-il, depuis 1761. Il meurt à 89 ans, à la fin du règne de Louis Philippe. L’histoire commence donc vers 1816, c’est à dire au début de la première Restauration, celle de Louis XVIII et s’achève en 1829.
Dans le Père Goriot (1835) qui se déroule pendant l’hiver 1819/1820, la relation amoureuse de Mme de Restaud et Maxime de Trailles est à son zénith. Gobseck nous éclaire sur certaines zones d’ombre de ce roman. On comprend par exemple pourquoi Anastasie de Restaud ne se rend pas au chevet de son père mourant : elle est en train de disputer à son mari l’héritage de ses enfants. Elle lutte pour sa survie et celle des deux enfants qui ne sont pas de son mari. Cette technique de la mise en scène d’une vie fragmentée, complexe, procure à l’œuvre de Balzac cette épaisseur peu égalée dans la littérature
En 1818/1819, Derville a 25 ans. Il s’apprête à entrer dans la vie active, ses études de droit terminées. Le roman, qui décrit l’activité d’un des plus importants usuriers de La Comédie Humaine, décrit également les conséquences de l’adultère d’une manière très crue (épisode de la fouille de la chambre où gît le cadavre de son mari par la comtesse Restaud) mais aussi d'une manière très sensuelle lorsque cette même Anastasie se présente à Gobseck dans sa tenue de nuit trasparente au milieu de ses vêtements éparpillés autour de son lit qui garde encore l'empreinte de son corps d'une beauté énervante.
Publié en 1830 avec d’importants rajouts en 1835, Gobseck, premier roman balzacien, est l’une des cellules mères de La Comédie Humaine. Il y est question des lettres de change, de revenus, d’héritage, de drames, de papiers timbrés présentés dans le texte avec une étonnante brutalité. Pour l’auteur, l’histoire secrète des familles, c’est l’histoire des fortunes.
Ce roman révèle en outre des éléments factuels qui nous permettent de le situer dans la temporalité de La Comédie Humaine. Ainsi nous apprenons que Gobseck est né vers 1740 - il est majeur, dit-il, depuis 1761. Il meurt à 89 ans, à la fin du règne de Louis Philippe. L’histoire commence donc vers 1816, c’est à dire au début de la première Restauration, celle de Louis XVIII et s’achève en 1829.
Dans le Père Goriot (1835) qui se déroule pendant l’hiver 1819/1820, la relation amoureuse de Mme de Restaud et Maxime de Trailles est à son zénith. Gobseck nous éclaire sur certaines zones d’ombre de ce roman. On comprend par exemple pourquoi Anastasie de Restaud ne se rend pas au chevet de son père mourant : elle est en train de disputer à son mari l’héritage de ses enfants. Elle lutte pour sa survie et celle des deux enfants qui ne sont pas de son mari. Cette technique de la mise en scène d’une vie fragmentée, complexe, procure à l’œuvre de Balzac cette épaisseur peu égalée dans la littérature
En 1818/1819, Derville a 25 ans. Il s’apprête à entrer dans la vie active, ses études de droit terminées. Le roman, qui décrit l’activité d’un des plus importants usuriers de La Comédie Humaine, décrit également les conséquences de l’adultère d’une manière très crue (épisode de la fouille de la chambre où gît le cadavre de son mari par la comtesse Restaud) mais aussi d'une manière très sensuelle lorsque cette même Anastasie se présente à Gobseck dans sa tenue de nuit trasparente au milieu de ses vêtements éparpillés autour de son lit qui garde encore l'empreinte de son corps d'une beauté énervante.
L’histoire
Le récit est fait par le jeune notaire Derville qui le raconte à Madame de Granlieu, l’une des dernières femmes du grand monde qui habite encore « le noble faubourg », le Faubourg Saint Germain. Mme de Granlieu est riche et son nom est ancien. L’histoire de Gobseck est racontée là, au sommet de la pyramide aristocratique parisienne. Connaissant les tenants et les aboutissants de cette histoire, Derville peut informer son hôtesse en toute connaissance.
Il faut savoir, pour comprendre la proximité qui unit dans la confidence une grande Dame de France à un subalterne social, que Derville avait obtenu la restitution des biens de la famille Granlieu confisqués par la révolution de 1789. Probe, savant, travailleur, modeste, l’avoué Derville n’avait jamais profité de ses succès dans les procès qu’il avait plaidé pour se faire connaître du grand monde. C’est ce qui avait séduit Madame de Granlieu et explique l’estime dans laquelle elle le tenait. Pour elle, Derville n’avait « pas une âme d’avoué » mais l’une de celles que l’on admire.
Les confidences sur la personnalité de Gobseck livrées à la grande Dame par l’avoué en présence de sa fille Camille sont motivées par l’intérêt qu’elle porte à l’usurier qui tient entre ses mains le destin de Madame de Restaud, la mère d’Ernest dont la jeune Camille est tombée amoureuse. La vicomtesse connaît la conduite scandaleuse de la comtesse et sa totale dépendance à son amant Maxime de Trailles qui la ruine et ruine sa famille. En perpétuel manque d’argent, criblé de dettes, il a contraint sa maîtresse à mettre en gage ses biens et ceux de son mari, volant de ce fait l’héritage de son propre fils.
Le récit est fait par le jeune notaire Derville qui le raconte à Madame de Granlieu, l’une des dernières femmes du grand monde qui habite encore « le noble faubourg », le Faubourg Saint Germain. Mme de Granlieu est riche et son nom est ancien. L’histoire de Gobseck est racontée là, au sommet de la pyramide aristocratique parisienne. Connaissant les tenants et les aboutissants de cette histoire, Derville peut informer son hôtesse en toute connaissance.
Il faut savoir, pour comprendre la proximité qui unit dans la confidence une grande Dame de France à un subalterne social, que Derville avait obtenu la restitution des biens de la famille Granlieu confisqués par la révolution de 1789. Probe, savant, travailleur, modeste, l’avoué Derville n’avait jamais profité de ses succès dans les procès qu’il avait plaidé pour se faire connaître du grand monde. C’est ce qui avait séduit Madame de Granlieu et explique l’estime dans laquelle elle le tenait. Pour elle, Derville n’avait « pas une âme d’avoué » mais l’une de celles que l’on admire.
Les confidences sur la personnalité de Gobseck livrées à la grande Dame par l’avoué en présence de sa fille Camille sont motivées par l’intérêt qu’elle porte à l’usurier qui tient entre ses mains le destin de Madame de Restaud, la mère d’Ernest dont la jeune Camille est tombée amoureuse. La vicomtesse connaît la conduite scandaleuse de la comtesse et sa totale dépendance à son amant Maxime de Trailles qui la ruine et ruine sa famille. En perpétuel manque d’argent, criblé de dettes, il a contraint sa maîtresse à mettre en gage ses biens et ceux de son mari, volant de ce fait l’héritage de son propre fils.
Gobseck
Jean Esther van Gobseck après avoir dépensé sa jeunesse dans des aventures extrêmes devient dans son âge mûr partisan de l’économie vitale pour se maintenir en vie. Bouger le moins possible c’est vivre le plus longtemps possible. Il donne l’exemple de Fontenelle qui aurait vécu de la sorte jusqu’à cent ans.
Du lever au coucher du soleil ses actions sont régulières, programmées pour éviter tout effort inutile. Il rejoint l’idée du forçat Vautrin dans : « Tout se résume à l’or. Je possède le monde sans fatigue. »
Gobseck habite rue des Grès, aujourd’hui rue Cujas, entre la rue Saint Jacques et le Boulevard Saint Michel, un quartier à l’époque dédié aux étudiants, aux artistes et aux grisettes. La maison qu’il occupe et lui se ressemblent. Ils ont le même air : sobre, sombre et propre. On dirait, écrit Balzac, l’huître et son rocher. En y entrant, toute gaîté s’efface, mais pas seulement à cause de la tristesse du lieu.
Au physique, Gobseck a une face lunaire, des cheveux gris cendrés, toujours bien peignés, un visage de bronze, des yeux jaunes « comme ceux d’une fouine », sans cils, et craignant la lumière à cause de cela, des lèvres minces comme ceux des « vieillards peints par Rembrandt. » Fils naturel d’une juive de Hollande, il est l’un des rares parents de « la Belle Hollandaise » - assassinée dans un hôtel borgne de Paris. Gobseck parait à Derville sans âge et « de sexe neutre, comme tous les usuriers » ajoute Balzac.
Si l’humanité est une religion sociale poursuit l’avoué, il faut considérer Gobseck comme athée. Il professe des idées simples sur la relativité de la vérité. Il part du constat que ce que l’Europe admire, l’Asie le punit. Et que ce qui est un vice à Paris est une nécessité quand on passe les Açores. Rien n’est fixe ici bas, dit-il à Derville, il n’existe que des conventions qui se modifient selon les climats.
« Vous croyez à tout. Moi je ne crois en rien » dit-il à Derville en exposant le relativisme des croyances humaines. Il décrit « la vie parisienne » en quelques mots en évoquant ceux « qui s’habillent pour les autres, qui mangent pour les autres et qui se glorifient d’un cheval ou d’une voiture que leurs voisins n’auront que trois jours après eux. » Il fustige Paris où les comtesses signent des billets à valeur de 1000 francs pour plaire à un jeune homme. Parlant de Mme de Restaud, il dit : « Cette comtesse se donnerait à son créancier plutôt que de ne pas payer, à cause du scandale que cela produirait dans sa famille. » Poursuivant son analyse sur ses contemporains, Gobseck distingue différents types de Parisiens :
- les fous qui jouent aux cartes pour gagner
- les sots qui se demandent si Mme Untelle s’est couchée seule sur son canapé ou en compagnie
- les dupes qui se croient utiles à leurs semblables
- les niais qui croient avoir de l’esprit en répétant les bons mots des autres.
Jean Esther van Gobseck après avoir dépensé sa jeunesse dans des aventures extrêmes devient dans son âge mûr partisan de l’économie vitale pour se maintenir en vie. Bouger le moins possible c’est vivre le plus longtemps possible. Il donne l’exemple de Fontenelle qui aurait vécu de la sorte jusqu’à cent ans.
Du lever au coucher du soleil ses actions sont régulières, programmées pour éviter tout effort inutile. Il rejoint l’idée du forçat Vautrin dans : « Tout se résume à l’or. Je possède le monde sans fatigue. »
Gobseck habite rue des Grès, aujourd’hui rue Cujas, entre la rue Saint Jacques et le Boulevard Saint Michel, un quartier à l’époque dédié aux étudiants, aux artistes et aux grisettes. La maison qu’il occupe et lui se ressemblent. Ils ont le même air : sobre, sombre et propre. On dirait, écrit Balzac, l’huître et son rocher. En y entrant, toute gaîté s’efface, mais pas seulement à cause de la tristesse du lieu.
Au physique, Gobseck a une face lunaire, des cheveux gris cendrés, toujours bien peignés, un visage de bronze, des yeux jaunes « comme ceux d’une fouine », sans cils, et craignant la lumière à cause de cela, des lèvres minces comme ceux des « vieillards peints par Rembrandt. » Fils naturel d’une juive de Hollande, il est l’un des rares parents de « la Belle Hollandaise » - assassinée dans un hôtel borgne de Paris. Gobseck parait à Derville sans âge et « de sexe neutre, comme tous les usuriers » ajoute Balzac.
Si l’humanité est une religion sociale poursuit l’avoué, il faut considérer Gobseck comme athée. Il professe des idées simples sur la relativité de la vérité. Il part du constat que ce que l’Europe admire, l’Asie le punit. Et que ce qui est un vice à Paris est une nécessité quand on passe les Açores. Rien n’est fixe ici bas, dit-il à Derville, il n’existe que des conventions qui se modifient selon les climats.
« Vous croyez à tout. Moi je ne crois en rien » dit-il à Derville en exposant le relativisme des croyances humaines. Il décrit « la vie parisienne » en quelques mots en évoquant ceux « qui s’habillent pour les autres, qui mangent pour les autres et qui se glorifient d’un cheval ou d’une voiture que leurs voisins n’auront que trois jours après eux. » Il fustige Paris où les comtesses signent des billets à valeur de 1000 francs pour plaire à un jeune homme. Parlant de Mme de Restaud, il dit : « Cette comtesse se donnerait à son créancier plutôt que de ne pas payer, à cause du scandale que cela produirait dans sa famille. » Poursuivant son analyse sur ses contemporains, Gobseck distingue différents types de Parisiens :
- les fous qui jouent aux cartes pour gagner
- les sots qui se demandent si Mme Untelle s’est couchée seule sur son canapé ou en compagnie
- les dupes qui se croient utiles à leurs semblables
- les niais qui croient avoir de l’esprit en répétant les bons mots des autres.
La société secrète des usuriers
Pour Gobseck l’or est une quintessence qui enferme une force incommensurable. Il peut donner le pouvoir et le plaisir : « Mon regard est comme celui de Dieu, je vois dans les cœurs. » Ils sont une dizaine à Paris, « rois silencieux et inconnus », à posséder cet immense pouvoir. Toutes les semaines ils se rencontrent dans un café, Le Thémis, près du Pont Neuf. Gobseck et ses amis détiennent dans leur Livre noir le secret de toutes les familles de la capitale. Les membres de cette société, très fermée et particulièrement informée, s’intéressent, chacun en ce qui le concerne, à un secteur de la vie parisienne. Gobseck « a l’œil sur les fils de famille, les artistes, les gens du monde, et sur les joueurs, la partie la plus émouvante de Paris. » Il dit que ses informations, il les obtient de ses « clients » eux-mêmes car « les passions trompées, les vanités froissées sont bavardes. Les vices, les désappointements, les vengeances sont les meilleurs agents de police. »
L’existence pour Gobseck c’est cela : « des plaies hideuses, des chagrins mortels, des scènes d’amour, des misères que les eaux de la seine attendent, des joies de jeune homme qui mènent à l’échafaud, des rires de désespoir et des fêtes somptueuses. »
Gobseck sait que grâce à son or il peut peser sur les ministres. Il a donc le Pouvoir. Il peut avoir de la même façon les plus belles femmes. Il a donc aussi le Plaisir. Il détient par conséquent tout ce que recherche et fait agir le monde. Chez lui, dans sa chambre nue et froide, tous les grands noms, hommes ou femmes, se mettent à genoux devant lui pour obtenir ce qu’ils ont perdu : l’argent et l’honneur.
Gobseck a compris que l’or est nécessaire à la vie du grand monde et il sait comment l’obtenir. La confession qu’il fait au notaire Derville relate les différentes étapes par lesquelles il est passé pour devenir ce roi de l’usure, ce prince de Paris, craint et respecté par le grand monde. Cet homme qui s’était fait or était appelé par ses victimes « Papa Gobseck ». Homme sans femme, il ne croit en rien (comme le père Grandet) et se veut philosophe, mais « philosophe cynique ». Son seul dieu, « cette chose » comme il dit, c’est l’or. Car « l’or contient tout en germe et donne tout en réalité ». Et cet or qu’il détient fait de Gobseck le dieu des parisiens vaniteux et futiles, exclusivement préoccupés d’eux-mêmes. Des comtesses, des ducs, des marquises viennent le voir, et s’humilient devant lui pour de l’argent. Et lui, indifférent et froid « comme le marbre », dit : « je suis là, inébranlable, comme un vengeur. J’apparais comme un remords. »
Lorsque Gobseck se déplace dans les riches demeures pour recevoir l’argent qu’on lui doit, il signe son passage en laissant sur les tapis la trace de ses souliers crottés pour faire comprendre aux riches qu’il est le maître. « Paie ton luxe, paie ton nom, paie ton bonheur, paie le monopole dont tu jouis. » Parfois, pourtant, il s’émeut quand il lui faut « pénétrer dans les plus secrets replis du cœur humain, épouser la vie des autres, et de les voir à nu. Gobseck a conscience de son pouvoir, il détient le moteur qui fait agir l’humanité : il possède l’or. « La vie n’est-elle pas une machine à laquelle l’argent imprime le mouvement. »
Cet or qu’il entasse, qu’il cache comme tout avare qui a besoin de connaître à tout moment le montant de sa fortune, une fortune à portée de ses mains, parce qu’il lui faut la regarder, la caresser, s’en repaître (Eugénie Grandet) comme s’il s’agissait d’une maîtresse qu’on soustrairait de la vue d’intrus ou de voleurs d’amour (La Fille aux yeux d’or.)
Pour Gobseck l’or est une quintessence qui enferme une force incommensurable. Il peut donner le pouvoir et le plaisir : « Mon regard est comme celui de Dieu, je vois dans les cœurs. » Ils sont une dizaine à Paris, « rois silencieux et inconnus », à posséder cet immense pouvoir. Toutes les semaines ils se rencontrent dans un café, Le Thémis, près du Pont Neuf. Gobseck et ses amis détiennent dans leur Livre noir le secret de toutes les familles de la capitale. Les membres de cette société, très fermée et particulièrement informée, s’intéressent, chacun en ce qui le concerne, à un secteur de la vie parisienne. Gobseck « a l’œil sur les fils de famille, les artistes, les gens du monde, et sur les joueurs, la partie la plus émouvante de Paris. » Il dit que ses informations, il les obtient de ses « clients » eux-mêmes car « les passions trompées, les vanités froissées sont bavardes. Les vices, les désappointements, les vengeances sont les meilleurs agents de police. »
L’existence pour Gobseck c’est cela : « des plaies hideuses, des chagrins mortels, des scènes d’amour, des misères que les eaux de la seine attendent, des joies de jeune homme qui mènent à l’échafaud, des rires de désespoir et des fêtes somptueuses. »
Gobseck sait que grâce à son or il peut peser sur les ministres. Il a donc le Pouvoir. Il peut avoir de la même façon les plus belles femmes. Il a donc aussi le Plaisir. Il détient par conséquent tout ce que recherche et fait agir le monde. Chez lui, dans sa chambre nue et froide, tous les grands noms, hommes ou femmes, se mettent à genoux devant lui pour obtenir ce qu’ils ont perdu : l’argent et l’honneur.
Gobseck a compris que l’or est nécessaire à la vie du grand monde et il sait comment l’obtenir. La confession qu’il fait au notaire Derville relate les différentes étapes par lesquelles il est passé pour devenir ce roi de l’usure, ce prince de Paris, craint et respecté par le grand monde. Cet homme qui s’était fait or était appelé par ses victimes « Papa Gobseck ». Homme sans femme, il ne croit en rien (comme le père Grandet) et se veut philosophe, mais « philosophe cynique ». Son seul dieu, « cette chose » comme il dit, c’est l’or. Car « l’or contient tout en germe et donne tout en réalité ». Et cet or qu’il détient fait de Gobseck le dieu des parisiens vaniteux et futiles, exclusivement préoccupés d’eux-mêmes. Des comtesses, des ducs, des marquises viennent le voir, et s’humilient devant lui pour de l’argent. Et lui, indifférent et froid « comme le marbre », dit : « je suis là, inébranlable, comme un vengeur. J’apparais comme un remords. »
Lorsque Gobseck se déplace dans les riches demeures pour recevoir l’argent qu’on lui doit, il signe son passage en laissant sur les tapis la trace de ses souliers crottés pour faire comprendre aux riches qu’il est le maître. « Paie ton luxe, paie ton nom, paie ton bonheur, paie le monopole dont tu jouis. » Parfois, pourtant, il s’émeut quand il lui faut « pénétrer dans les plus secrets replis du cœur humain, épouser la vie des autres, et de les voir à nu. Gobseck a conscience de son pouvoir, il détient le moteur qui fait agir l’humanité : il possède l’or. « La vie n’est-elle pas une machine à laquelle l’argent imprime le mouvement. »
Cet or qu’il entasse, qu’il cache comme tout avare qui a besoin de connaître à tout moment le montant de sa fortune, une fortune à portée de ses mains, parce qu’il lui faut la regarder, la caresser, s’en repaître (Eugénie Grandet) comme s’il s’agissait d’une maîtresse qu’on soustrairait de la vue d’intrus ou de voleurs d’amour (La Fille aux yeux d’or.)
La comtesse et l’ouvrière
Pour ses affaires, chaque jour, Gobseck court dans Paris d’une « jambe sèche comme celle d’un cerf. » Deux procédures de recouvrement de lettres de change sont décrites au moment où commence le récit. Gobseck a deux billets de 1000 francs à se faire rembourser. L’un d’une comtesse, l’autre d’une ouvrière. La comtesse, Mme de Restaud, loge rue du Helder. L’ouvrière, Fanny Malvaut, rue Montmartre. Gobseck se demande malicieusement l’attitude qu’elles allaient adopter en le voyant sonner chez elles dès le petit matin.
Il commence ses visites par la Chaussée d’Antin où habitent les Restaud. Le faubourg Saint Germain s’est déplacé là, pour des raisons économiques. Cette partie de la capitale est moins cotée que le Faubourg Saint Germain car s’installent dans ce quartier les nouveaux riches, le haute galanterie, de grands restaurants, des salons de jeux et des clubs attirant une population bruyante, mélangée et dépensière.
Introduit dans l’hôtel Restaud, le domestique prévient l’usurier que la comtesse dort encore. Qu’elle est rentée à trois heures du matin d’un bal. Elle sera visible à midi. Gobseck n’insiste pas et se retire.
Il poursuit sa tournée en se rendant chez Fanny Malvaux. L’adresse de la jeune fille, lorsqu’il arrive devant chez elle, correspond à une maison de peu d’apparence. Après avoir franchi la porte cochère il traverse une cour où ne pénètre jamais le soleil. Une loge noire où se tenait le portier complète le tableau, une loge au « vitrage gras, brun, lézardé. ». Fanny est absente mais elle a laissé l’argent. Gobseck préfère attendre et s’attarde sur le boulevard en regardant les gravures étalées devant la boutique des libraires.
A midi, il est de retour chez la Comtesse. Il est reçu dans sa chambre. Anastasie est là, presque nue, « magnifique et fragile » malgré « la vie et la force » qui se dégagent d’elle. Gobseck enregistre de son œil expert les craquelures visibles qui annoncent le futur désastre. Ayant dans sa vie « brocanté des tableaux », la beauté de cette femme alanguie lui rappelle une scène de Michel Ange. La comtesse, superbe dans ses traits et ses formes, ne présentait rien de mesquin au milieu des diamants, des escarpins, des bas, des jarretelles, de la robe légère éparpillés autour du lit défait, encore tiède du corps qui venait juste d’en sortir. La sensualité presque animale de cette femme faite pour l’amour trouble profondément le vieil homme. Derville ressentira la même chose plus tard lorsqu’il se rendra chez elle pendant l’agonie du comte. A voir cette femme au sortir d’une nuit qu’il ne peut imaginer qu’amoureuse, Gobseck éprouve un terrible besoin de la posséder, prêt à sacrifier ce billet de 1000 francs qu’il est justement venu récupérer. Il est sur le point de céder à l’attraction magnétique qu’exercent les beaux corps « qui dorment sur la soie et sous la soie ». Mais la nature méfiante de Gobseck (et le souvenir d’un échec cuisant) remonte à la surface et, malgré les tentatives de séduction de la comtesse, redevient le froid usurier et la menace de poursuites. Effrayée (elle a « la chair de poule »), elle lui tend un diamant pour prix de la lettre de change. En sortant, Gobseck croise Maxime de Trailles, l’amant qui vient retrouver sa maîtresse.
Gobseck retourne chez Fanny. Il monte un escalier raide jusqu’au 5ème étage. Il entre dans un appartement de deux pièces, très propre. Fanny le reçoit ; c’est une jeune fille parisienne, vêtue simplement, sans prétention, avec une tête élégante, bien coiffée avec des yeux bleus. Un jour tamisé par de jolis rideaux éclaire ce coquet logis. Elle s’excuse de son absence le matin et l’explique par le fait que travaillant la nuit, il ne lui reste qu’un petit moment le matin pour aller se baigner. Gobseck comprend que cette jeune fille « est condamnée au travail par le malheur. » Les quelques points de rousseur qui criblent la peau de son visage attestent de son origine paysanne. Chez elle Gobseck découvre la Vertu, la Sincérité et la Candeur. Il est touché et est sur le point de l’aider. Mais il se raisonne et renonce pour rester fidèle à sa stricte ligne de conduite. Selon lui « la bienfaisance qui ne nuit pas au bienfaiteur, tue l’obligé »
Mais il ne peut s’empêcher de comparer la pure et innocente Fanny à la comtesse « qui était tombée dans la lettre de change » et qui bientôt tombera dans « l’abîme du vice. » Il peut ainsi deviner les motivations des personnages à qui il a affaire. Ainsi de Fanny Malvaut qu’il aidera parce qu’il sent qu’elle est bonne et sérieuse et qu’elle est victime de sa condition d’ouvrière sans protection. Ce n’est pas une grisette, une fille. Elle est pure. Elle gagne sa vie honnêtement. Ainsi de la comtesse de Restaud qu’il méprise et à qui il prédit qu’elle « roulera jusqu’au fond des abîmes du vice. »
Pour ses affaires, chaque jour, Gobseck court dans Paris d’une « jambe sèche comme celle d’un cerf. » Deux procédures de recouvrement de lettres de change sont décrites au moment où commence le récit. Gobseck a deux billets de 1000 francs à se faire rembourser. L’un d’une comtesse, l’autre d’une ouvrière. La comtesse, Mme de Restaud, loge rue du Helder. L’ouvrière, Fanny Malvaut, rue Montmartre. Gobseck se demande malicieusement l’attitude qu’elles allaient adopter en le voyant sonner chez elles dès le petit matin.
Il commence ses visites par la Chaussée d’Antin où habitent les Restaud. Le faubourg Saint Germain s’est déplacé là, pour des raisons économiques. Cette partie de la capitale est moins cotée que le Faubourg Saint Germain car s’installent dans ce quartier les nouveaux riches, le haute galanterie, de grands restaurants, des salons de jeux et des clubs attirant une population bruyante, mélangée et dépensière.
Introduit dans l’hôtel Restaud, le domestique prévient l’usurier que la comtesse dort encore. Qu’elle est rentée à trois heures du matin d’un bal. Elle sera visible à midi. Gobseck n’insiste pas et se retire.
Il poursuit sa tournée en se rendant chez Fanny Malvaux. L’adresse de la jeune fille, lorsqu’il arrive devant chez elle, correspond à une maison de peu d’apparence. Après avoir franchi la porte cochère il traverse une cour où ne pénètre jamais le soleil. Une loge noire où se tenait le portier complète le tableau, une loge au « vitrage gras, brun, lézardé. ». Fanny est absente mais elle a laissé l’argent. Gobseck préfère attendre et s’attarde sur le boulevard en regardant les gravures étalées devant la boutique des libraires.
A midi, il est de retour chez la Comtesse. Il est reçu dans sa chambre. Anastasie est là, presque nue, « magnifique et fragile » malgré « la vie et la force » qui se dégagent d’elle. Gobseck enregistre de son œil expert les craquelures visibles qui annoncent le futur désastre. Ayant dans sa vie « brocanté des tableaux », la beauté de cette femme alanguie lui rappelle une scène de Michel Ange. La comtesse, superbe dans ses traits et ses formes, ne présentait rien de mesquin au milieu des diamants, des escarpins, des bas, des jarretelles, de la robe légère éparpillés autour du lit défait, encore tiède du corps qui venait juste d’en sortir. La sensualité presque animale de cette femme faite pour l’amour trouble profondément le vieil homme. Derville ressentira la même chose plus tard lorsqu’il se rendra chez elle pendant l’agonie du comte. A voir cette femme au sortir d’une nuit qu’il ne peut imaginer qu’amoureuse, Gobseck éprouve un terrible besoin de la posséder, prêt à sacrifier ce billet de 1000 francs qu’il est justement venu récupérer. Il est sur le point de céder à l’attraction magnétique qu’exercent les beaux corps « qui dorment sur la soie et sous la soie ». Mais la nature méfiante de Gobseck (et le souvenir d’un échec cuisant) remonte à la surface et, malgré les tentatives de séduction de la comtesse, redevient le froid usurier et la menace de poursuites. Effrayée (elle a « la chair de poule »), elle lui tend un diamant pour prix de la lettre de change. En sortant, Gobseck croise Maxime de Trailles, l’amant qui vient retrouver sa maîtresse.
Gobseck retourne chez Fanny. Il monte un escalier raide jusqu’au 5ème étage. Il entre dans un appartement de deux pièces, très propre. Fanny le reçoit ; c’est une jeune fille parisienne, vêtue simplement, sans prétention, avec une tête élégante, bien coiffée avec des yeux bleus. Un jour tamisé par de jolis rideaux éclaire ce coquet logis. Elle s’excuse de son absence le matin et l’explique par le fait que travaillant la nuit, il ne lui reste qu’un petit moment le matin pour aller se baigner. Gobseck comprend que cette jeune fille « est condamnée au travail par le malheur. » Les quelques points de rousseur qui criblent la peau de son visage attestent de son origine paysanne. Chez elle Gobseck découvre la Vertu, la Sincérité et la Candeur. Il est touché et est sur le point de l’aider. Mais il se raisonne et renonce pour rester fidèle à sa stricte ligne de conduite. Selon lui « la bienfaisance qui ne nuit pas au bienfaiteur, tue l’obligé »
Mais il ne peut s’empêcher de comparer la pure et innocente Fanny à la comtesse « qui était tombée dans la lettre de change » et qui bientôt tombera dans « l’abîme du vice. » Il peut ainsi deviner les motivations des personnages à qui il a affaire. Ainsi de Fanny Malvaut qu’il aidera parce qu’il sent qu’elle est bonne et sérieuse et qu’elle est victime de sa condition d’ouvrière sans protection. Ce n’est pas une grisette, une fille. Elle est pure. Elle gagne sa vie honnêtement. Ainsi de la comtesse de Restaud qu’il méprise et à qui il prédit qu’elle « roulera jusqu’au fond des abîmes du vice. »
Gobseck aide Derville à acquérir son étude
Les fréquentes visites qu'effectue Derville chez Gobseck leur permettent de mieux se connaître. Un lien d'amitié se tisse entre ces deux hommes que tout oppose. Pour l'avoué Derville Gobseck est le « capitaliste » par excellence. Il est capable de tirer 50%, parfois 100 ou 200, et même 500% de ses fonds. A ce titre, voulant s’établir à son compte, il se résout à lui emprunter la somme nécessaire à l’achat d’une étude. Après discussion, Gobseck accepte de lui prêter la somme nécessaire et ils décident de continuer à se voir. Un programme est établi : ils dîneront tous les mercredis et samedis, à 5 heures – après la fermeture de la bourse. Gobseck lui promet de l’aider dans sa recherche de la clientèle et compte lui faire des révélations sur les hommes et surtout les femmes pour mieux apprendre à les connaître. L’une des conclusions à laquelle son expérience de l’âme humaine lui a permis d’arriver c’est, curieusement, qu’un homme qui a dépassé la trentaine ne peut plus être ni probe, ni talentueux.
Les fréquentes visites qu'effectue Derville chez Gobseck leur permettent de mieux se connaître. Un lien d'amitié se tisse entre ces deux hommes que tout oppose. Pour l'avoué Derville Gobseck est le « capitaliste » par excellence. Il est capable de tirer 50%, parfois 100 ou 200, et même 500% de ses fonds. A ce titre, voulant s’établir à son compte, il se résout à lui emprunter la somme nécessaire à l’achat d’une étude. Après discussion, Gobseck accepte de lui prêter la somme nécessaire et ils décident de continuer à se voir. Un programme est établi : ils dîneront tous les mercredis et samedis, à 5 heures – après la fermeture de la bourse. Gobseck lui promet de l’aider dans sa recherche de la clientèle et compte lui faire des révélations sur les hommes et surtout les femmes pour mieux apprendre à les connaître. L’une des conclusions à laquelle son expérience de l’âme humaine lui a permis d’arriver c’est, curieusement, qu’un homme qui a dépassé la trentaine ne peut plus être ni probe, ni talentueux.
L’amant, la maîtresse, l’usurier
Un an après le début de cette histoire Derville, qui a professionnellement réussi, rencontre dans un dîner de garçons « la fleur du dandysme de cette époque » : Maxime de Trailles. Ce jeune homme au physique avantageux s’y connaît « en chapeaux, en chevaux, en tableaux » et est passé maître dans l’art de feindre une passion sans rien ressentir. C’est le type parfait d’hommes dont les femmes raffolent, le « type de la chevalerie errante de nos salons, de nos boudoirs, de nos boulevards, espèce amphibie qui tient autant de l’homme que de la femme, bon à tout et propre à rien » qui les ruine en les manoeuvrant par la vanité, la jalousie, le plaisir
Ne voulant pas être taxé de « béguelisme », Derville qui continue à être reçu chez Mme de Granlieu, décide de raconter à Mme de Granlieu et à sa fille Camille ce dîner qui débute dans la plus grande des corrections et s’achève dans le désordre le plus total (cette scène sera reprise et développée en 1830 dans un chapitre de La Peau de Chagrin intitulé Une Orgie.)
Lors de ce dîner bien arrosé, Maxime réussit, en utilisant « la langue dorée » des séducteurs, à convaincre Derville de le conduire chez Gobseck. A la porte de l’usurier le dandy, le front en sueur, « verdit, blêmit, rougit ». Gobseck, imperturbable, l’attend. Il ressemblait alors, dit le notaire, à la statue de Voltaire placée devant le théâtre-Français. Une affaire de billet à honorer le jour même doit se régler. La comtesse de Restaud, elle-même, arrive et donne, bien en deça de leurs valeurs, ses diamants en paiement de cette dette. Derville voit pour le première fois cette femme admirablement belle. Il se souvient de la description de son lever que lui avait faite Gobseck. Quatre années plus tard, elle est aussi belle qu’il l’avait imaginée, malgré l’angoisse dans laquelle elle semble désormais vivre. Derville comprend qu’elle est tenue par son amant « par tous les ressorts possibles » et que ce dernier lui a « vendu bien cher de criminels plaisirs. » Par amour pour Maxime, elle a sacrifié ses enfants, son mari et son père, le fameux père Goriot.
Derville la voit hors de son milieu naturel, dans ce quartier populaire indigne d’elle. Et il la voit chez un usurier à casquette qui se moque d’elle et l’humilie en lui parlant de la Cour où elle ne peut plus aller. Derville est témoin de la réalité cachée du monde : une grande femme au nom aristocratique et un dandy à la mode quémandant de l’argent à un Gobseck. Maxime pourtant, en quittant les lieux à la suite de la comtesse, va se ressaisir et menace l’usurier qui lui répond, méprisant : « pour jouer son sang, il faut en avoir, mon petit, et tu n’as que de la boue dans les veines. » Pour lui, ces jeunes gens, « ces viveurs » paresseux, sont gâtés par « les restaurants qui proposent trop de coulis, de sauces, de vins qui empoisonneraient le diable. »
Gobseck est l’homme qui sait parce qu’il a tout fait. Il observe aujourd’hui les mobiles cachés des hommes. Son regard est celui de Dieu, c'est-à-dire celui de l’écrivain. Il voit dans les cœurs. Don de voir, don de faire, grâce à l’or – qu’il donne ou non selon son humeur, son plaisir, ses convictions ou le plus souvent, son intuition. Il incarne la providence, souveraine et lucide, qui est mieux que le destin, le fatum aveugle. Parce qu’il a le vouloir et le pouvoir.
Un an après le début de cette histoire Derville, qui a professionnellement réussi, rencontre dans un dîner de garçons « la fleur du dandysme de cette époque » : Maxime de Trailles. Ce jeune homme au physique avantageux s’y connaît « en chapeaux, en chevaux, en tableaux » et est passé maître dans l’art de feindre une passion sans rien ressentir. C’est le type parfait d’hommes dont les femmes raffolent, le « type de la chevalerie errante de nos salons, de nos boudoirs, de nos boulevards, espèce amphibie qui tient autant de l’homme que de la femme, bon à tout et propre à rien » qui les ruine en les manoeuvrant par la vanité, la jalousie, le plaisir
Ne voulant pas être taxé de « béguelisme », Derville qui continue à être reçu chez Mme de Granlieu, décide de raconter à Mme de Granlieu et à sa fille Camille ce dîner qui débute dans la plus grande des corrections et s’achève dans le désordre le plus total (cette scène sera reprise et développée en 1830 dans un chapitre de La Peau de Chagrin intitulé Une Orgie.)
Lors de ce dîner bien arrosé, Maxime réussit, en utilisant « la langue dorée » des séducteurs, à convaincre Derville de le conduire chez Gobseck. A la porte de l’usurier le dandy, le front en sueur, « verdit, blêmit, rougit ». Gobseck, imperturbable, l’attend. Il ressemblait alors, dit le notaire, à la statue de Voltaire placée devant le théâtre-Français. Une affaire de billet à honorer le jour même doit se régler. La comtesse de Restaud, elle-même, arrive et donne, bien en deça de leurs valeurs, ses diamants en paiement de cette dette. Derville voit pour le première fois cette femme admirablement belle. Il se souvient de la description de son lever que lui avait faite Gobseck. Quatre années plus tard, elle est aussi belle qu’il l’avait imaginée, malgré l’angoisse dans laquelle elle semble désormais vivre. Derville comprend qu’elle est tenue par son amant « par tous les ressorts possibles » et que ce dernier lui a « vendu bien cher de criminels plaisirs. » Par amour pour Maxime, elle a sacrifié ses enfants, son mari et son père, le fameux père Goriot.
Derville la voit hors de son milieu naturel, dans ce quartier populaire indigne d’elle. Et il la voit chez un usurier à casquette qui se moque d’elle et l’humilie en lui parlant de la Cour où elle ne peut plus aller. Derville est témoin de la réalité cachée du monde : une grande femme au nom aristocratique et un dandy à la mode quémandant de l’argent à un Gobseck. Maxime pourtant, en quittant les lieux à la suite de la comtesse, va se ressaisir et menace l’usurier qui lui répond, méprisant : « pour jouer son sang, il faut en avoir, mon petit, et tu n’as que de la boue dans les veines. » Pour lui, ces jeunes gens, « ces viveurs » paresseux, sont gâtés par « les restaurants qui proposent trop de coulis, de sauces, de vins qui empoisonneraient le diable. »
Gobseck est l’homme qui sait parce qu’il a tout fait. Il observe aujourd’hui les mobiles cachés des hommes. Son regard est celui de Dieu, c'est-à-dire celui de l’écrivain. Il voit dans les cœurs. Don de voir, don de faire, grâce à l’or – qu’il donne ou non selon son humeur, son plaisir, ses convictions ou le plus souvent, son intuition. Il incarne la providence, souveraine et lucide, qui est mieux que le destin, le fatum aveugle. Parce qu’il a le vouloir et le pouvoir.
Le mari
Après le départ des deux amants, le mari fait son entrée chez Gobseck. Il a dû suivre sa femme et attendre qu’elle sorte pour se présenter au « capitaliste ».
Le comte de Restaud ressemble au duc de Richelieu. Son allure et son aspect le désignent comme faisant partie de la caste restreinte des vrais aristocrates. Il est immédiatement reconnaissable. Il désire récupérer les bijoux laissés par sa femme car, juridiquement, Mme de Restaud étant « en puissance de mari » ne peut rien entreprendre sans son accord.
Mais il est trop tard et un procès serait long, onéreux, incertain et désastreux pour son nom. Derville voit chez l’homme trompé un sot « comme un homme passionné » alors que Gobseck voit en lui un sot « comme un honnête homme. » Derville devine dans ce drame qui se joue devant ses yeux « les terribles mystères de la vie d’une femme à la mode. » Gobseck décide de venir en aide au Comte en sauvant ce qui lui reste de biens – il lui en reste encore beaucoup - afin de préserver l’héritage de ses trois enfants. Gobseck, en vrai homme d'affaires, considère que « l’argent est une marchandise que l’on peut vendre cher ou bon marché. » Il met ses talents d’argentier au service du comte parce que, dit-il, « il n’a pas essayé de me tromper. »
Après le départ des deux amants, le mari fait son entrée chez Gobseck. Il a dû suivre sa femme et attendre qu’elle sorte pour se présenter au « capitaliste ».
Le comte de Restaud ressemble au duc de Richelieu. Son allure et son aspect le désignent comme faisant partie de la caste restreinte des vrais aristocrates. Il est immédiatement reconnaissable. Il désire récupérer les bijoux laissés par sa femme car, juridiquement, Mme de Restaud étant « en puissance de mari » ne peut rien entreprendre sans son accord.
Mais il est trop tard et un procès serait long, onéreux, incertain et désastreux pour son nom. Derville voit chez l’homme trompé un sot « comme un homme passionné » alors que Gobseck voit en lui un sot « comme un honnête homme. » Derville devine dans ce drame qui se joue devant ses yeux « les terribles mystères de la vie d’une femme à la mode. » Gobseck décide de venir en aide au Comte en sauvant ce qui lui reste de biens – il lui en reste encore beaucoup - afin de préserver l’héritage de ses trois enfants. Gobseck, en vrai homme d'affaires, considère que « l’argent est une marchandise que l’on peut vendre cher ou bon marché. » Il met ses talents d’argentier au service du comte parce que, dit-il, « il n’a pas essayé de me tromper. »
Gobseck – La fin
Ce tableau serait incomplet si je ne rappelais le tic langagier de Gobseck : « Vrai – Possible – Juste » et les premiers signes de la folie qui le guette – la description du vieil homme contemplant les diamants de Mme de Restaud offre le spectacle d’un vieillard/enfant envoûté par le scintillement des pierres précieuses au point qu’il ne s’aperçoit pas qu’il parle seul.
Fatigué, perdant la raison, cet esprit supérieur s'enferme chez lui. Ce retrait de la vie active annonce la fin de cet homme cloué à son idée fixe - sa passion exclusive de l’or. Deux exceptions sont tout de même à noter : son amitié pour Derville et sa compassion à l’égard du comte de Restaud.
Le délire qui s’empare de lui, alors qu’il est devenu jaune comme un citron (en rappel de madame Grandet « jaune comme un coing »), sonne l’heure où « il doit rendre ses derniers comptes. » Gobseck meurt au milieu des marchandises avariées qu’il n’a pas voulu vendre mais non sans avoir légué sa fortune à la jeune prostituée Esther (la Torpille d’Illusions perdues) qui se suicidera sans savoir qu’elle se suicide millionnaire (Splendeurs et Misères des courtisanes.)
Ce tableau serait incomplet si je ne rappelais le tic langagier de Gobseck : « Vrai – Possible – Juste » et les premiers signes de la folie qui le guette – la description du vieil homme contemplant les diamants de Mme de Restaud offre le spectacle d’un vieillard/enfant envoûté par le scintillement des pierres précieuses au point qu’il ne s’aperçoit pas qu’il parle seul.
Fatigué, perdant la raison, cet esprit supérieur s'enferme chez lui. Ce retrait de la vie active annonce la fin de cet homme cloué à son idée fixe - sa passion exclusive de l’or. Deux exceptions sont tout de même à noter : son amitié pour Derville et sa compassion à l’égard du comte de Restaud.
Le délire qui s’empare de lui, alors qu’il est devenu jaune comme un citron (en rappel de madame Grandet « jaune comme un coing »), sonne l’heure où « il doit rendre ses derniers comptes. » Gobseck meurt au milieu des marchandises avariées qu’il n’a pas voulu vendre mais non sans avoir légué sa fortune à la jeune prostituée Esther (la Torpille d’Illusions perdues) qui se suicidera sans savoir qu’elle se suicide millionnaire (Splendeurs et Misères des courtisanes.)
Derville se sent redevable à Gobseck
Derville explique à Mme de Granlieu la dualité de Gobseck, avare et philosophe, petit et grand. « Il a peut être été trafiquant de diamants ou d’hommes, de femmes ou de secrets d’état », reconnaît-il, mais il a toujours été fiable. Devant de telles horreurs Derville semble se souvenir qu’une jeune fille, Camille de Granlieu, l’écoute aussi. Il incrimine alors les journaux qui publient tous les jours de cruelles et sordides histoires, semblables à celle qu’il vient de raconter. La vicomtesse le rassure en s’étonnant que Derville puisse penser une telle chose. « Camille ne lit pas les journaux » lui lance-t-elle rejoignant l’animosité de Balzac à l’égard de la presse.
Toujours est-il que de ce drame, une morale doit être tirée pour Camille. C’est Derville qui se charge de la lui formuler sous forme d’une mise en garde. Il lui recommande de se méfier des belles paroles chuchotées par les séducteurs de profession qui savent flatter la vanité endormie des jeunes filles. Un compliment, une belle tournure, un œil ou une voix de velours et le tour est joué. On devient facilement une autre Anastasie de Restaud. Etonnament il reprend à son compte une parole de Gobseck qu’il laisse à Camille le soin de méditer : « la vie est un travail, un métier qu’il faut se donner la peine d’apprendre. »
Derville explique à Mme de Granlieu la dualité de Gobseck, avare et philosophe, petit et grand. « Il a peut être été trafiquant de diamants ou d’hommes, de femmes ou de secrets d’état », reconnaît-il, mais il a toujours été fiable. Devant de telles horreurs Derville semble se souvenir qu’une jeune fille, Camille de Granlieu, l’écoute aussi. Il incrimine alors les journaux qui publient tous les jours de cruelles et sordides histoires, semblables à celle qu’il vient de raconter. La vicomtesse le rassure en s’étonnant que Derville puisse penser une telle chose. « Camille ne lit pas les journaux » lui lance-t-elle rejoignant l’animosité de Balzac à l’égard de la presse.
Toujours est-il que de ce drame, une morale doit être tirée pour Camille. C’est Derville qui se charge de la lui formuler sous forme d’une mise en garde. Il lui recommande de se méfier des belles paroles chuchotées par les séducteurs de profession qui savent flatter la vanité endormie des jeunes filles. Un compliment, une belle tournure, un œil ou une voix de velours et le tour est joué. On devient facilement une autre Anastasie de Restaud. Etonnament il reprend à son compte une parole de Gobseck qu’il laisse à Camille le soin de méditer : « la vie est un travail, un métier qu’il faut se donner la peine d’apprendre. »
La comtesse Anastasie de Restaud
Derville revoit la comtesse de Restaud rue du Helder. Elle s’est fanée, corps et visage, mais elle reste digne sous son masque de femme du monde. Le notaire veut voir le comte qui est sur le point de mourir. Il fait cette demande dans l’intérêt des enfants. Anastasie, se sentant intuitivement en danger, s’y oppose poliment mais fermement.
L'avoué est fasciné par Anastasie et reconnaît que la nature l’avait beaucoup aidée. Il se souvient qu’après avoir entendu les confidences de Gobseck au début de cette histoire, il était rentré chez lui et s’était endormi en rêvant non de l’honnête Fanny mais de la sensuelle et ardente Anastasie. Pour l’heure, à deux pas du lit où son mari agonise, la comtesse se fait pour lui tour à tour caressante, fière, souple, confiante et tente « d’allumer » sa curiosité, « d’éveiller l’amour » dans son cœur pour le dominer. Mais, comme naguère lors sa tentative de séduction de Gobseck, elle échoue et immédiatement se met à le haïr.
Le comte, malade, interdit sa chambre à sa femme et aux deux enfants qui ne sont pas de lui. Elle se met à l’assiéger, lui mourant dans l’obscurité de sa chambre, elle dans le salon qu’elle ne quitte plus, guettant et épiant, à l’affût de la moindre parole de son mari qui lui indiquerait l’endroit où il a caché son testament.
Après l’humiliante rupture avec Maxime de Trailles, Mme de Restaud s’est acquis l’amour de ses fils, la fidélité de ses domestiques et le respect de quelques bigotes ignorantes, surprises par tant d’abnégation conjugale et d’amour maternel. Ceux qui connaissaient son histoire disaient qu’elle rachetait ses fautes. Mais elle demeure aux yeux du monde « une femme mal née », présentée dans le roman comme « une mère qui mangeait des millions. »
Indifférente à ce qui se disait d’elle, la comtesse n’attendait que la mort et la fortune de son mari. Cette détermination était guidée par l’amour pour ses enfants, réel celui-là, et regrettant ses passions passées, aspirant désormais à une sorte de paix vertueuse.
Derville revoit la comtesse de Restaud rue du Helder. Elle s’est fanée, corps et visage, mais elle reste digne sous son masque de femme du monde. Le notaire veut voir le comte qui est sur le point de mourir. Il fait cette demande dans l’intérêt des enfants. Anastasie, se sentant intuitivement en danger, s’y oppose poliment mais fermement.
L'avoué est fasciné par Anastasie et reconnaît que la nature l’avait beaucoup aidée. Il se souvient qu’après avoir entendu les confidences de Gobseck au début de cette histoire, il était rentré chez lui et s’était endormi en rêvant non de l’honnête Fanny mais de la sensuelle et ardente Anastasie. Pour l’heure, à deux pas du lit où son mari agonise, la comtesse se fait pour lui tour à tour caressante, fière, souple, confiante et tente « d’allumer » sa curiosité, « d’éveiller l’amour » dans son cœur pour le dominer. Mais, comme naguère lors sa tentative de séduction de Gobseck, elle échoue et immédiatement se met à le haïr.
Le comte, malade, interdit sa chambre à sa femme et aux deux enfants qui ne sont pas de lui. Elle se met à l’assiéger, lui mourant dans l’obscurité de sa chambre, elle dans le salon qu’elle ne quitte plus, guettant et épiant, à l’affût de la moindre parole de son mari qui lui indiquerait l’endroit où il a caché son testament.
Après l’humiliante rupture avec Maxime de Trailles, Mme de Restaud s’est acquis l’amour de ses fils, la fidélité de ses domestiques et le respect de quelques bigotes ignorantes, surprises par tant d’abnégation conjugale et d’amour maternel. Ceux qui connaissaient son histoire disaient qu’elle rachetait ses fautes. Mais elle demeure aux yeux du monde « une femme mal née », présentée dans le roman comme « une mère qui mangeait des millions. »
Indifférente à ce qui se disait d’elle, la comtesse n’attendait que la mort et la fortune de son mari. Cette détermination était guidée par l’amour pour ses enfants, réel celui-là, et regrettant ses passions passées, aspirant désormais à une sorte de paix vertueuse.
Epilogue
A la mort du comte de Restaud, Derville qui s'occupe désormais des affaires de Camille et du jeune Eugène de Restaud. Celui-ci, grâce à la volonté de Gobseck qui avait décidé de sauver sa fortune et au travail incessant de l'avoué, récupère une grande partie des biens dilapidés par sa mère. Mme de Granlieu ne peut plus s'opposer au mariages deux jeunes gens et accorde la main de Camille à l'héritier du comte.
Gobseck qui avait parlé de Fanny Malvaux, l'honnête ouvrière décrite au début du roman, la présente à Derville. Séduit par tant de fraîcheur et d'innocence, l'avoué l'épouse. Installés confortablement, les deux nouveaux mariés vont s'aimer longtemps, sans passion et sans folie, à l'abri des pièges tendus par la vie mondaine. Cette fin heureuse que ne prévoyait pas ce drame, Balzac se l'impose pour respecter les règles qui commandaient en son temps l'écriture du roman.
A la mort du comte de Restaud, Derville qui s'occupe désormais des affaires de Camille et du jeune Eugène de Restaud. Celui-ci, grâce à la volonté de Gobseck qui avait décidé de sauver sa fortune et au travail incessant de l'avoué, récupère une grande partie des biens dilapidés par sa mère. Mme de Granlieu ne peut plus s'opposer au mariages deux jeunes gens et accorde la main de Camille à l'héritier du comte.
Gobseck qui avait parlé de Fanny Malvaux, l'honnête ouvrière décrite au début du roman, la présente à Derville. Séduit par tant de fraîcheur et d'innocence, l'avoué l'épouse. Installés confortablement, les deux nouveaux mariés vont s'aimer longtemps, sans passion et sans folie, à l'abri des pièges tendus par la vie mondaine. Cette fin heureuse que ne prévoyait pas ce drame, Balzac se l'impose pour respecter les règles qui commandaient en son temps l'écriture du roman.

/image%2F1270432%2F20221224%2Fob_ddc87d_retour-a-kristel.jpeg)